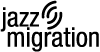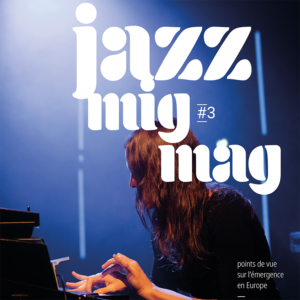Portée par l’intensification de nouvelles dynamiques d’échanges et la création de projets entre acteur·rices du jazz et des musiques improvisées, la diffusion internationale au sein du réseau AJC continue d’évoluer jour après jour. Pour s’y retrouver, voici un panorama d’initiatives soutenues et portées par le réseau et de projets partenariaux ouverts à la coopération, autant de réflexions sur les mobilités de demain que sur la pertinence des actions de réseaux.
Par Antoine Bos et Lucas Le Texier

Europe, mon amour
Depuis ses débuts sous feu AFIJMA, AJC a posé comme enjeu majeur de son action les mobilités : celles des artistes comme des professionnel·les du secteur et nombre de ses projets se jouent sur ce terrain.
Le continent européen est en effet aujourd’hui le terrain de jeu le plus travaillé par AJC. Il y accompagne ses adhérents lors de leur déplacement au salon Jazzahead!, à la découverte du jazz européen et des acteur·rices de celui-ci. Dans un souci de réciprocité, il invite aussi près de 80 programmateur·rices européen·nes chaque année à venir découvrir le jazz français sur des festivals et lieux membres d’AJC. Depuis plus de 20 ans, les échanges entre AJC et le reste de l’Europe ont permis la création d’un réseau solide entre diffuseurs français et européens, encourageant de nombreuses collaborations artistiques et culturelles. Cette question de la mobilité des professionnel·les est d’ailleurs au cœur des problématiques de l’Europe Jazz Network (EJN). Le réseau a créé quelques années auparavant le Staff Exchange Program, un dispositif offrant la possibilité aux professionnel·les du réseau EJN de se déplacer chez un autre membre à la découverte d’un pays, d’une structure et de nouvelles manières de faire “le métier”.
Au-delà des professionnel·les, le Vieux Continent se trouve être de longue date au cœur de nombreuses initiatives de diffusion du jazz et des musiques improvisées. Précurseur, le travail de Charles Gil sur la Finlande, la Scandinavie et maintenant les pays Baltes, qui monte plusieurs tournées par an avec des artistes français·es en appliquant les préceptes du Slow Touring. Una Striscia di Terra Feconda, Jazzdor Berlin, deux pierres – angulaires – posées sur les sols romains et berlinois à quelques années d’intervalle, pour marquer de nouveaux espaces de diffusion mais surtout de relations entre les artistes de jazz français·es et leurs homologues italien·nes et allemand·es. La relation forte et ancienne entre France et Suisse maintenue et renforcée année après année par AJC et Pro Helvetia pour favoriser la présence d’artistes Suisses en France. Des initiatives comme le système de résidence croisée portée par le Petit Faucheux entre la saxophoniste française Léa Ciechelski et le saxophoniste belge Bo van der Werf, témoignent autant du souhait d’un lieu historique du jazz français de remettre au coeur l’Europe que d’une stratégie pour “augmenter durablement la visibilité et la diffusion de ses artistes régionaux·ales”. Car il s’agit de cela in fine : installer les conditions idéales pour qu’artistes français·es et européen·nes se croisent, se nourrissent les un·es des autres, créent et se diffusent.
C’est justement pour soutenir cette diffusion, rendue encore plus complexe lorsqu’elle mêle artistes français·es et musicien·nes des 4 coins de l’Europe, qu’AJC lançait en 2024 la première édition de Jazz With, un nouveau programme de soutien à la diffusion des projets franco-européens. Une première sélection qui a retenu trois groupes : Weave 4, Cheel et T.I.M, mêlant artistes français·es, norvégien·nes, italien·nes, allemand·es et britanniques. Bénéficiant d’un double accompagnement, financier et professionnel, Jazz With permet de travailler la diffusion et la création de tournées en Europe pour ces différents projets. L’un des objectifs d’une telle diffusion internationale consiste en la fabrication de tournées. Donc, bannir les one-shot pour un double enjeu : éviter la fatigue des groupes, et rationaliser économiquement et écologiquement les déplacements des artistes. Alors que 30% des dates Jazz Migration impliquent au moins deux dates collées, le dispositif Jazz With ambitionne les mêmes effets et la même succession de dates à plus grande échelle, celle-ci européenne. Ce sont ces mêmes problématiques qu’envisage de résoudre l’EJN et son Green Pilot Tour. Alors que Charles Gil en a été l’un des précurseurs en Europe du Nord, le réseau européen du jazz pousse à la mise en place de tournées optimisées et intenses qui permettraient de réduire l’empreinte écologique des déplacements des artistes et favoriser de nouvelles collaborations entre structures de diffusion.
Les « au-délà »
A l’heure où les critères d’empreinte écologique s’invitent dans les aides à la diffusion ou à la mobilité, il s’agit de ne pas oublier les spécificités de certains territoires. Pour La Réunion, la nécessité absolue du transport aérien pour l’accueil comme pour le déplacement d’artistes semble de prime abord difficilement conciliables avec des objectifs de décarbonation. Pour autant, les professionnel·les du territoire ultramarin s’organisent déjà pour mutualiser les tournées et partager les coûts entre structures. Quand l’insularité questionne la pertinence d’une date sèche dans un territoire où la mobilité reste onéreuse[1], le modèle des résidences croisées, plutôt développées dans les mondes du théâtre ou de la danse sur des durées longues – un à deux mois -, fait ainsi partie des réflexions portées par le champ musical réunionnais pour penser globalement création, diffusion, actions de territoires, etc.
Loin des logiques européennes, le territoire des États-Unis, terrain de jeu de The Bridge, initiative portée par Alexandre Pierrepont. Quatre tournées par an, aux États-Unis et en France, sur des temps plus ou moins longs – quinze jours à trois semaines, et des groupes montés par les musicien·nes elleux-mêmes. Les enjeux sont de taille entre ces deux territoires aux logiques de diffusions différentes. A contrario des enjeux de l’identification d’un « jazz français » qui se posent à l’échelle européenne, les musicien·nes et groupes hexagonaux sont perçu·es à Chicago comme appartenant au vaste ensemble du jazz européen. Outre-Atlantique, ce projet de rencontre entre musicien·nes Nord-américain·es et Français·es est diffusé dans des espaces de deux ordres : des lieux « Do It Yourself », avec peu de moyens, essentiellement à Chicago et aux alentours ; et des universités qui accueillent ces combos pour des concerts, des masterclass et des tables rondes. Alors que les mondes européens ont rationalisé le spectacle vivant entre professionnel·les de la diffusion et artistes, les musicien·nes Américain·es de Chicago ont pris des initiatives dès les années 60 et 70 pour s’occuper de la diffusion de leur musique en créant des salles qu’ils ont confié à des musicien·nes ou des collectifs d’artistes. En France et sur le reste du Vieux Continent, The Bridge s’appuie sur un réseau de fidèles constitué de salles de spectacles et de festivals qui essaime loin. Le projet est un appel aux collaborations inédites suscitées par ces tournées, provoquées par les musicien·nes et les lieux qui les accueillent. Mais il est surtout l’un des seuls projets à avoir été capable de s’insérer dans le paysage américain de manière durable, à y avoir construit un réseau d’acteur·rices et de lieux investis et à avoir finalement sans le vouloir et sans le savoir, pensé “tournées optimisées” avant l’heure.
Facteurs de réseaux
Toutes ces collaborations illustrent comment le champ de la diffusion s’est fait de plus en plus large, débutant aux frontières françaises jusqu’à s’envisager dans un espace européen et mondial. Chacunes de ces initiatives reposent sur des connexions, des réseaux d’acteur·rices informels comme ceux qu’ont installés The Bridge ou Charles Gil, ou formels comme ceux qui sous-tendent l’action internationale d’AJC ou de l’EJN. Mais de nouveaux réseaux semblent à l’œuvre pour accompagner la diffusion du jazz en sus des réseaux de diffusion “officiels”.
En 2023, le projet Landscape porté par AJC, le Périscope et le Bimhuis s’était donné pour objectif de de récolter des données autour de la transition écologique, de former les professionnel·les du jazz à cette question tout en imaginant de nouvelles pratiques de diffusion et en utilisant de nouvelles dynamiques.
Des lieux culturels de proximité, cafés de village, brasseries du coin ou refuges en haute montagne deviennent ainsi salles de concerts, centres d’un tissu social vertueux qui permet de repenser les enjeux de l’alimentation responsable et des liens humains dans un respect des écosystèmes. Ces petits lieux permettent aussi d’optimiser les mobilités des publics et, dans le cadre de montage de tournées, celles des artistes. Deux sujets parmi les principaux facteurs d’empreinte carbone de la diffusion du jazz.
Ce modèle vertueux des petits lieux et d’un réseau coopératif peut-il être reproduit ailleurs et à une autre échelle ? C’est autour de cette idée que le projet européen Better Live, porté par le Périscope et augmenté de nombreux partenaires européens, a été imaginé. Une diffusion repensée, grâce à l’élaboration de réseaux locaux – LAG, local action groups – qui favorisent la coopération et la mutualisation des tournées entre petites, moyennes et grandes structures. Ces LAG poursuivent deux objectifs. D’une part, la multiplication des concerts dans un réseau travaillé et conscientisée par les acteur·rices, qui permet de réduire l’empreinte carbone des tournées en minimisant les déplacements des artistes et des publics. D’autre part, des outils de mise en relation entre acteur·rices, qui permettent d’améliorer la diffusion des artistes sur les territoires nationaux et internationaux et d’envisager une réplicabilité à moyen terme de ces nouveaux circuits de diffusion.
Better Live permet aussi d’approfondir les enjeux des différents territoires européens. Au réseau fortement institutionnalisé en France s’oppose des modèles comme celui de l’Espagne avec moins de financements publics limitant les prises de risques des programmations. Pour autant, ce modèle se double d’atouts, comme la présence de lieux de jazz dans toutes les moyennes villes et l’habitude de travailler en co-programmation, ce qui favorise le montage de tournées plus responsables. La taille modeste de la Slovénie amène les petits lieux et les espaces institutionnels à travailler ensemble de manière plus naturelle et à se connaître plus facilement. L’identification de ces réseaux de diffusion leur permet de communiquer plus facilement et de penser “mutualisations de dates”. En Grèce, au moment où les professionnel·les cherchent plutôt à faire survivre leur lieu, la présence de Better Live se présente moins comme une proposition visant à « décarboner » les tournées qu’une aide à la « coproduction » de celles-ci. Si les mots diffèrent, les objectifs visés se rejoignent.
Les enseignements de Better Live sur ses nouveaux espaces de diffusion européens nourrissent les prochaines réflexions d’un réseau comme AJC et ses futurs projets. La décalque des LAG sur le monde musical français pourrait faciliter le montage de tournées. Surtout, le travail des différent·es acteur·rices dans les LAG pourraient faciliter la collaboration et l’identification de nouvelles structures de diffusion d’un même territoire, et ouvrir des opportunités de diffusion à des lieux et festivals qui échappent à toutes les classifications. Autant de nouveaux circuits qu’il faudra rendre autonomes, et qu’une mutualisation de la diffusion ne pourra que renforcer. Autant d’espaces de solidarité qui doivent être accompagnés face à l’urgence écologique et économique de la diffusion de nos musiques aujourd’hui.