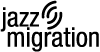Par Alexandre Pierrepont
Puisqu’il s’agirait ces-jours-ci de la survie du « monde de la culture », qui est une industrie aussi, et une industrie mal en point comme presque toutes les autres, puisqu’il s’agirait des moyens à déployer pour continuer à inventer avec ivresse, avec allégresse… pourrait-on imaginer de se plonger dans « une longue marche », comme si la route sous nos pas devenait une rivière, comme sur le disque enregistré par Archie Shepp et Max Roach, un soir d’été au Willisau Jazz Festival, en 1979, et intitulé « The Long March », en référence aux révolutionnaires chinois d’un autre temps ?
Leur deuxième titre, U-Jaa-Ma, renvoie à l’un des 7 principes du Nguzu Saba, mis au point dans les années 1960 par les nationalistes culturels du Maulana Karenga et de son organisation United Slaves. Lors de la fête de Kwanza, qui dure une semaine et qui est célébrée chaque année depuis par des millions d’Africains Américains, un chandelier à sept bougies est allumé. Chaque jour, on en éteint une, en appelant de ses vœux la réalisation de l’un des 7 principes du Nguzu Saba, pour l’avenir de la communauté et du monde. Ujamaa correspond au troisième jour et prône une économie basée sur les coopératives : tenir ses propres boutiques, développer ses propres magasins et services, en tirer profit ensemble, jusqu’à l’effacement du profit individuel. Tout comme Ujamaa, les six autres principes correspondent plutôt très adéquatement à ce qui se passe le plus souvent, quand on les laisse libres de s’organiser, ou quand ils en prennent la responsabilité, entre les musicien.ne.s du champ jazzistique, dans leurs musiques même. Ils sont moins un étiquetage politique ou une profession de foi qu’une philosophie, pratiquée aussi bien par Erykah Badu que par Angel Bat Dawid, en passant par Wadada Leo Smith.
Quel que soit le moment de l’histoire, nous sommes toujours plongés dans une triple temporalité : un temps court, un temps moyen et un temps long. L’histoire a plusieurs longueurs, plusieurs vitesses pour les parcourir, et nous vivons dans plusieurs temporalités. La temporalité longue n’a pas nécessairement les clés de la temporalité courte, mais nous passons tellement de temps en compagnie de cette dernière qu’elle a tendance à nous obnubiler, à nous faire oublier tout ce qui la dépasse, les autres longueurs, les autres dimensions. Ainsi, aujourd’hui que tout tremble de nouveau sur ses bases, ses fondations, notre réflexion ne doit pas seulement porter sur l’industrie musicale ou culturelle, mais sur la vie en société, peut-être une autre vie, dont les musiques du champ jazzistique nous proposent tant de fascinants microcosmes. Il s’agit d’un point majeur puisque, anthropocène ou capitalocène, notre planète souffre actuellement des logiques d’extractivisme et de productivisme venues du même monde que celui qui a eu besoin de l’esclavage pour développer son agriculture industrielle. De la transplantation de toute une partie d’une population d’un continent à un autre, sous l’autorité d’une autre population elle-même issue d’un troisième continent, a surgi cette prolifération de musiques qui ont rebattu les cartes de ce que l’on entend par là, par ça, par l’organisation et la désorganisation populaire et expérimentale des voix et des rythmes, des sons et des silences.
Il y a quelques années, lors d’un forum sur « l’évolution du jazz », Angela Davis fit ce commentaire incisif : « Car la musique de jazz est toujours davantage que la musique qui nous bouleverse, nous inspire et nous édifie. Et cette musique, en retour, est toujours davantage que le terreau social sur lequel elle est produite. La musique de jazz suggère en effet la possibilité de quelque chose comme la pratique de la liberté. Ce qui me passionne à propos du jazz, ce sont les possibilités, et devrais-je ajouter les possibilités politiques. Non que le jazz va transformer le monde, mais le jazz a le pouvoir de transformer. »
Angela Davis affirme donc ici que la musique agit de façon indirecte, et c’est crucial, mais enfin agit, agit sur les consciences, sans leur dicter quoi faire exactement. Elle contient des puissances, dont une puissance transformatrice qui a besoin de se mélanger à ce qu’elle traverse pour être activée, pour modifier et être elle-même modifiée – peut-être est-ce l’une des missions confiées à ce qu’on appelle « l’art » dans les sociétés occidentales, entretenir le cycle des métamorphoses ? Et Angela Davis a raison de rester prudente quant à « la pratique de la liberté », qu’il ne faudrait pas délimiter, mais que nous savons reconnaître et ressentir, quand elle se propage, en nous et à travers nous.

En 1961, à Los Angeles, le pianiste Horace Tapscott créa, littéralement sur les mêmes bases que celles du Nguzu Saba, ce que certains considèrent comme le premier collectif de l’histoire du « jazz ». Quelques années auparavant, au début de sa carrière, Horace Tapscott avait été tromboniste dans le grand orchestre de Lionel Hampton, vivant ce que l’on croit trop souvent être la vie de musicien, vivant en tournée, tournant sans vivre. Jusqu’au jour où il décida de revenir chez lui, dans son quartier aussi, de se « reterritorialiser » pourrait-on dire et de changer sa manière de partager au quotidien la musique, « pour qu’elle soit acceptée comme un élément entrant dans la composition de la société que nous rêvons tous de connaître ».
Ainsi, les musiciens de l’Union of God’s Musicians and Artists Ascension (UGMAA) se produisirent dans les rues, les parcs et les centres sociaux du ghetto de la cité des Anges. Ils investirent South Park, qu’ils transformèrent en jardin de liesse, héritèrent d’une petite imprimerie sur Vermont Avenue — The Shop — où ils installèrent leur quartier général, proposant à la population des services d’édition en plus de leurs improvisations dans l’arrière-boutique. Ils investirent des temples et des immeubles parfois vacants pour y créer des UGMAA Houses, comptant cantine, dortoir et foyer d’accueil, autant que salle de répétition école de musique et école du monde. Ils fondèrent également l’UGMAA Fine Arts Institute, en collaboration avec l’Université de Californie à Riverside, et le Pan Afrikan Peoples Arkestra, une grande formation rassemblant la plupart des membres de l’UGMAA et professant la gratuité des concerts, le partage équitable des bénéfices sinon, la participation de tous à la vie de la communauté et à l’édification de la jeunesse dans une atmosphère résolument non compétitive. « Nous pensions que si nous parvenions à faire monter la musique de la communauté, tous s’y habitueraient et comprendraient son propos et pourquoi son propos est celui-là, de construire le monde. Et de cette manière, nous les aiderions à participer à la musique, car le monde, c’est eux autant que la musique. »
D’un côté, cette arche offrait refuge à toutes les formes musicales, recherches et expérimentations. De l’autre, elle les disséminait comme du pollen de voix et de rythmes, de sons et de silences, au gré de la vie quotidienne. Les musicien.ne.s de l’Arkestra devinrent rapidement des figures familières, des sources d’inspiration et de cohésion sociale. Ils vivaient dans le voisinage, répétaient et donnaient des concerts dans les lieux publics, distribuaient flûtes et percussions pour que tout le monde y participât. Ils collectaient des aliments dans les magasins et les offraient aux familles lors de leurs performances, se produisaient dans les écoles, collèges et lycées. Ils accueillaient des professeurs bénévoles qui proposaient aux enfants, aux adolescents et aux personnes à la rue des cours de rattrapage en lecture, écriture, histoire, en arts martiaux. Ils intervenaient dans les prisons, les hôpitaux, les hospices, et dans certains meetings politiques – Elaine Brown, la dernière Présidente du Black Panther Party, eut recours à Horace Tapscott pour enregistrer ses deux disques.
Plus récemment, Kendrick Lamar, qui connaît l’histoire, qui connaît son histoire, ses différentes temporalités, a montré la même communauté à l’œuvre dans son clip pour la chanson Not Like Us. Le rappeur californien, disciple aussi des Watts Prophets qui firent partie de ceux qui animèrent des ateliers d’écriture dans les écoles alternatives montées par l’UGMAA, n’y fait pas que régler des comptes avec Drake, avec son appropriation mercantile des musiques nées de l’expérience noire d’un monde moderne qui tarde à s’assumer aux couleurs de l’arc-en-ciel, du spectre électromagnétique. Tout ça pour le plus grand plaisir de l’industrie culturelle (in)justement, laquelle ne goûte qu’à petites doses cyniques les valeurs profondes du rap (pour Revolutionary Arts Proverbalization) ou du Nguzo Saba. Afin d’illustrer sa diatribe, Kendrick Lamar implique toute la communauté de Watts. Il fait apparaître familles, camarades, voisins de quartier et commerçants, membres de différents gangs, des symboles, des visions, des fantômes… dans la continuité de l’histoire et de la légende de l’UGMAA. Pouvoirs et puissances de la musique pratiquant la liberté. All Power to the People qui font la musique, qui n’en ont pas fini de reconstruire un monde toujours en crise depuis qu’il est tel qu’il est, un monde dans lequel l’esclavage sous toutes ses formes, y compris l’esclavage économique et professionnel, n’aurait plus de raison d’être.