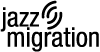Les spécificités de la diffusion dans les espaces ultramarins avaient été interrogées en 2022 lors d’une table ronde « Outre-mer et international », reprise dans le Jazz Mig Mag #2. Pour compléter ces réflexions, et en lien avec la présence de Sėlēnę dans la selecta Jazz Migration #10, Jazz Mig Mag #5 a interrogé plusieurs professionnel·les de la Réunion invité·es aux Rencontres AJC pour cartographier l’écosystème d’une île aux enjeux de diffusion à la croisée de la France, de l’Europe et de l’océan Indien.
Par Lucas Le Texier
En écho et en contraste des réalités territoriales en France métropolitaine, les spécificités de l’île de La Réunion et de l’océan Indien émergent. La Réunion fait partie des îles d’outre-mer les mieux équipées en infrastructures culturelles. Tout comme les activités et le tourisme, les structures de diffusion n’échappent pas à leur concentration du côté ouest de l’île. On y compte le Kabardock à Le Port, seule SMAC de La Réunion, le Léspas culturel Leconte de Lisle à Saint-Paul, le TEAT Plein Air à Saint-Paul, un des théâtres départementaux, et le Séchoir de Saint-Leu, Scène conventionnée. Au nord, à Saint-Denis, le TEAT Champ Fleuri, second théâtre départemental et la Cité des Arts avec une salle de diffusion de concert, le Palaxa. Au Sud, la salle du Keverguen à Saint-Pierre, diffuseur de musiques actuelles. Même profil pour la salle située à l’Est, le Bisik, à Saint-Benoit. Si la plupart des structures sont pluri-disciplinaires, la musique occupe une place de choix – jusqu’à 30% de la programmation au Séchoir, confirme Niv Rakotondrainibe, administratrice de production. « La plupart des salles programment des musiques actuelles, dont le jazz. Il peut y avoir un week-end ou une soirée dédiée » confirme Alain Courbis de la plateforme de ressources dédiée au jazz sur l’île, JazzRenyon. En l’absence de club dédié, les temps forts de la diffusion du jazz sur l’île sont les deux festivals qui lui sont consacrés : Jazz Dann Port dans la ville du Port et Jazz en l’air porté par le TEAT Plein Air à Saint-Paul, deux événements nés en 2024. Autre festival estival, Opus Pocus, également très orienté jazz sans lui être complètement dédié. Restent les petits lieux, petits clubs, cafés-concerts qui permettent aux musicien·nes de jazz de compter sur quelques cachets sur des répertoires de standards ou contre l’animation de jam-sessions.
Mutualisations, circulations
A la charge de cet écosystème de répondre à la double problématique de l’île : l’insularité et son marché restreint ; et l’éloignement du marché national. « Les enveloppes régionales sur l’aide à la professionnalisation ont permis à beaucoup de technicien·nes et d’artistes de se professionnaliser. De 200 groupes de musique à la fin des années 90, on est passé à 400-500. Les gens ont pu sortir de l’île ou y revenir mais aujourd’hui, on se retrouve avec trop de propositions par rapport au nombre de lieux de diffusion » confie David Picot, directeur du Léspas. Soutenu·es par des écoles de jazz comme l’École des musiques actuelles (EMA) à Saint-Leu, les musicien·nes sont de plus en plus nombreux·ses et d’un niveau technique toujours plus élevé. Une situation qui n’est pas sans conséquence sur la diffusion. Cette situation complique l’obtention et la conservation du régime de l’intermittence pour les musicien·nes réunionnais·es, dont la plupart occupent un métier à côté de leur carrière.
Les festivals jouent le jeu en programmant en première partie des artistes de jazz locaux·ales. Côté diffusion sur la Réunion, des dispositifs existent : le Pôle Régional des Musiques Actuelles (PRMA) porte Tournée générale (TéGé) pour aider les petits lieux à rémunérer les groupes. L’Office National de Diffusion Artistique (ONDA) propose une aide pour des résidences d’équipes artistiques venant des territoires ultramarins, en métropole ou non. Côté aides à la mobilité, le Fonds Régional d’Aide à la Mobilité (FRAM) finance les billets d’avions des musicien·nes lors des tournées à l’extérieur, à partir de trois dates dans l’océan Indien ou de cinq dates dans l’Union Européenne et la France hexagonale. Il permet d’exporter ainsi une dizaine de groupes par an. La Spedidam propose une aide « Déplacement à l’international » qui s’active à partir de trois dates à l’étranger. L’insularité et la distance géographique de la métropole rendent ces structures très dépendantes de ces aides.
Afin de faire venir les musicien·nes sur l’île, la mutualisation des tournées et la répartition des coûts en fonction des moyens de chacun est indispensable. « Généralement, quand on monte une tournée, on la fait sur les quatre points cardinaux de l’île » note Anthony Virassamy, administrateur de production musique à la Cité des Arts. « L’idée, c’est que l’artiste fasse au moins deux dates, trois si on y parvient, car faire venir un groupe pour un one shot à la Réunion est de moins en moins pertinent » poursuit Niv Rakotondrainibe. Se laisser du temps, donc, à rebours du modèle de diffusion où les têtes d’affiches calent un passage sur l’île entre deux dates. Les professionnel·les reconnaissent les bénéfices des rencontres entre musicien·nes réunionnais·es et extérieur·es à l’île qui sont bénéfiques pour toutes les parties, sur l’action culturelle locale et sur les dynamiques de création que ces échanges créés sur l’île. Soutenues un temps par un dispositif de résidence croisée grâce au centre national de la Musique (CNM) et aux pouvoirs publics locaux, ces rencontres deviennent de plus en plus complexes par la lourdeur administrative et surtout l’exigence de la diffusion. « Je me plains qu’on me demande de faire trop de diffusion, et je préférerais faire plus d’accompagnement pour permettre ces émulations » explique Thierry Boyer, directeur des deux TEAT départementaux. Les expériences, bien que peu nombreuses, ont esquissé des possibilités. En 2024, le festival Jazz en l’air avait accueilli le big band de la radio publique allemande SWR pour une collaboration avec le pianiste Meddy Gerville.
Malgré ses différents exemples, il reste difficile d’envoyer des musicien·nes réunionnais·es dans d’autres espaces. De l’avis des professionnel·les, les venues des artistes sur l’île restent plus faciles grâce aux aides des bureaux d’export des pays, à condition d’y organiser une tournée. Avant-poste français et petite terre d’Europe dans l’océan Indien, la Réunion est déjà un point de passage clé pour les artistes de la région. L’enjeu reste donc de faciliter la circulation des artistes sur des temps longs pour nourrir davantage le terreau artistique local et, in fine, faciliter son développement international.

Insularité et marchés
Si l’insularité et la distance de la métropole sont sources de problématiques, la localisation de l’île au cœur de l’océan Indien crée d’autres réseaux. A Mayotte, mais aussi dans les Comores à Maurice, au Mozambique, à Madagascar, en Afrique du Sud, jusqu’en Inde ou en Chine, les musicien·nes réunionnais·es circulent, grâce aux Instituts Français, aux Alliances Françaises ou à des partenariats privés. « C’est déjà ce qui se passe dans nos appels à projets, insiste Anthony Virassamy. Les artistes proposent des résidences croisées avec des artistes de la zone océan Indien, ce qui permet de créer des passerelles pour elleux, et de donner lieu à des diffusions d’un nouveau genre ou d’une nouvelle création pour nous ». Dans le réseau du jazz, le Cape Town Festival et le Joburg Festival en Afrique du Sud apparaissent comme des partenaires, bien que les relations soient encore timides. « Il y a des artistes de la Réunion qui auraient tout à fait leur place sur ces scènes. Mais ils ne connaissent nos artistes et nos infrastructures que trop peu » continue Thierry Boyer.
Outre cette méconnaissance, les différents circuits artistiques des alentours diffèrent assez largement de l’échelle de l’écosystème de l’île. « Les pays invitent généralement les artistes réunionnais·es s’iels sont pris·es en charge par leur ambassade ou leur institution. Les cachets sont souvent ridicules, n’atteignant pas le minimum de chez nous. Les musicien·nes y vont pour l’expérience humaine mais économiquement, ça ne peut pas rentrer dans un projet de développement de carrière » soupire Alain Courbis. C’est ainsi que le festival Madajazzcar, le plus ancien festival de l’océan Indien, peine à garnir sa programmation d’artistes étranger·ères. Les questions de sécurité et d’instabilité dans la région rendent parfois ces coopérations difficiles à mettre en place ou à maintenir. Le marché des musiques de l’océan Indien (IOMMA) permet néanmoins aux acteur·rices de la région de se retrouver dans un espace d’échanges et de collaborations. Davantage orienté world music, le salon a évoqué récemment la question de la diffusion dans le jazz spécifiquement. Certaines pratiques de programmation des groupes ultramarins peuvent répondre directement aux enjeux de décarbonation portés par AJC : la sélection de Sėlēnę dans le dernier cru Jazz Migration concentre les tournées, adapte les parcours. Cet exemple concret de coopération commune entre l’île et l’hexagone pourrait être mis à mal si l’on ajoutait aux critères des aides à la mobilité, ceux de la décarbonation stricto censu. « Quand on est à 10 000 km du marché européen, si tout le monde se met à réfléchir en termes de bilan carbone, on n’a plus un artiste qui sortira de chez nous » selon Alain Courbis. Toutes ces questions rappellent la singularité de l’espace réunionnais.
La nécessité de mettre en place une continuité et un suivi pour perpétuer ces pratiques semble indispensable. A l’instar du travail engagé par de nombreuses institutions et structures pour renforcer la relation La Réunion-Hexagone, améliorer les dispositifs dédiés aux mobilités des musicien·nes et renforcer les partenariats dans l’océan Indien pourraient profondément faciliter la circulation des artistes sur et en dehors de l’île.