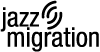Tu penses qu’on peut parler de scènes régionales ultramarines ?
Oui et certaines rayonnent même à l’international. À l’image de sa société partagée entre la modernité et la tradition, la musique guyanaise actuelle est composée de beaucoup de rappeurs, de chanteurs de dancehall. À La Réunion, on retrouve des musiciens très ancrés dans la tradition. En Guadeloupe et en Martinique, il y a un terreau fertile de musiciens de jazz. Je pense à Mario Canonge, Thierry Fanfant ou encore Sonny Troupé. Ces grands musiciens se retrouvent à jouer avec Kassav’, Ayo ou Jain, sont donc reconnus internationalement, mais pas en France. Il y a un problème de visibilité en métropole.
La métropole ne voit pas ces scènes comme régionales ?
Le problème, c’est que contrairement aux Bretons, on va nous mettre très facilement, quoi qu’on fasse, dans la case world music. Une case à laquelle on n’appartient pas ! On fait de la musique qui devrait être considérée comme musique française. Et la métropole devrait être fière de revendiquer que ce soit aussi ça, la musique française. C’est un vrai problème et on n’a pas la priorité sur les scènes world, parce qu’on reste des Français.
Les projets ultra-marins souffrent-ils d’être jugés d’abord comme projets ultramarins ?
Oui mais je sens qu’il y a une compréhension qui se fait, qui va de pair avec des changements sociétaux comme le mouvement #MeToo ou la reconnaissance de la traite négrière.
Qu’est-ce qui bloque encore ?
Peut-être la mentalité de quelques tourneurs et de programmateurs, de gens du milieu qui pensent que cette culture n’intéresse personne en métropole. Mais la société rattrape ces mentalités. En revanche, je sens que les artistes d’Outre-Mer sont extrêmement décomplexés. Les choses se font et se vivent avec beaucoup de spontanéité, parfois malgré le manque de structures et de scènes.
Penses-tu que ces manques forgent cette décomplexion ?
Oui. C’est aussi ce que disait Christiane Taubira : « Vous devez nager dans l’adversité, mais est-ce que de certains points de vue, ce n’est pas bénéfique ? Dans une forme de lutte quotidienne qui nourrit votre art ». Je crois aussi qu’il y a un peu de ça. On travaille encore plus dur pour donner tort à celles et ceux qui ne veulent pas nous entendre. Quand on est ultramarin, il faut être agile, malin et obstiné.