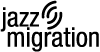Diffusion à la Réunion, état des lieux
Les spécificités de la diffusion dans les espaces ultramarins avaient été interrogées en 2022 lors d’une table ronde « Outre-mer et international », reprise dans le Jazz Mig Mag #2. Pour compléter ces réflexions, et en lien avec la présence de Sėlēnę dans la selecta Jazz Migration #10, Jazz Mig Mag #5 a interrogé plusieurs professionnel·les de la Réunion invité·es aux Rencontres AJC pour cartographier l’écosystème d’une île aux enjeux de diffusion à la croisée de la France, de l’Europe et de l’océan Indien.