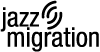Si on se glisse dans la faille entrebâillée en début d’article par Joachim Florent au sujet du mot émergence, on peut atteindre un autre sujet de réflexion qui mérite un peu d’intérêt. Est-ce que le gap entre les définitions du principe d’émergence peut être soluble dans celui qui sépare une génération d’une autre ? Dit autrement, à considérer l’émergence d’un groupe ou d’un.e musicien.ne, la condescendance du regard ne rentrerait-elle pas trop en jeu ? Joachim Florent détaille : « Cette question rejoint la problématique de l’écoute intergénérationnelle ; on dirait que beaucoup de diffuseurs souhaiteraient que tel ou tel jeune groupe se développe de manière professionnelle en les liant avec leur public. Alors que ce que tel ou tel jeune groupe pourrait souhaiter, c’est que les diffuseurs leur trouvent la juste place dans leur programmation correspondant à la musique qu’ils jouent. Il peut effectivement y avoir dans cette attitude un brin de paternalisme. » et Delphine de jouer l’effet miroir : « À l’inverse, je me pose plutôt cette question : considère- t-on assez les musicien.ne.s et les groupes pas encore ‘officiellement’ émergents ? ». On vous laisse le temps de la réponse, à peine bousculée par une autre idée, signée Morgane Carnet : « On considère (les groupes émergents) comme des jeunes groupes, d’un côté, c’est logique. Après, la créativité chez les groupes émergents peut être plus riche et intense que chez nos aîné.e.s, il y a plus d’innovations ». Jolie chose, la nouveauté qui arrive sans citer gare. Fidel Fourneyron éclaire : « J’ai quelques souvenirs d’avoir eu le sentiment d’être là parce qu’on était ‘le groupe low cost’ pour remplir une case et sans une vraie envie du programmateur, de ne pas être au bon endroit au bon moment pour que la musique soit reçue dans de bonnes conditions, mais ils sont vraiment rares et anecdotiques. La plupart du temps, il y avait une vrai envie de faire découvrir des musiques moins ’repérées’ dans de très bonnes conditions, et ça marchait très bien ! ».
Quelques ratées, des ajustements, mais encore ? Quels seraient les manques à combler en programmation ? Quelles aides complémentaires pourrait-on inventer du côté des institutions et des dispositifs ? On passe sur le revers de la médaille. Souplesse, lucidité, technique. Joachim Florent : « Je suis loin de connaître tous les dispositifs mis en place pour soutenir la jeune création, néanmoins, il me semble que ceux-ci forment des cadres un peu trop imperméables. On voit pas mal de propositions s’appuyant sur le concept de professionnalisation, genre résidence sur le plateau, création lumière, réaliser une maquette ou carrément des stages de réseaux sociaux et autre ‘Comment faire le buzz’. À mon sens, l’artiste, qu’il soit en devenir, en construction ou installé dans sa pratique, a en premier lieu la nécessité de présenter son travail au monde. Pour des jeunes musicien. ne.s, le plus important est de pouvoir jouer, si possible dans des conditions décentes, tous les autres aspects ne sont que des corollaires. » Pause. Remise en jeu, balles neuves. Leila Martial prolonge le propos de Joachim Florent : « Il faut des lieux de jeu. Plus de lieux et d’occasions de jouer, de se produire. Dans les festivals : des off, des out, des side, pas que du IN. Il faut permettre aux bars de programmer et faciliter cela par des dispositifs financiers. Les artistes ont besoin de lieux pour travailler en immersion et sur des temps longs. On pourrait mettre à dispo des musicien. ne.s des lieux et des défraiements repas en échange d’un atelier de sensibilisation sur quelques heures, par exemple. Il faut pratiquer les échanges. Tout devrait pouvoir se partager et se transmettre. C’est un aller-retour entre le laboratoire interne et le don. On a construit une forteresse où l’artiste se sent tantôt unique et sacré.e, et tantôt délaissé.e et inexistant.e. Il faut aussi remettre de la légèreté et du jeu dans l’art, c’est avant tout du partage ! Les lieux doivent transpirer cet état d’esprit ». Jeu set et match ? Pas certain.
Morgane Carnet apporte une nuance au constat précédent : « Bien entendu, on peut tout améliorer mais j’ai le sentiment qu’on est quand même pas trop mal loti.e.s en France. Après, la difficulté se situe au niveau de l’ouverture musicale, de la prise de risque d’une programmation expérimentale, si on sort trop de la mouvance, ça n’est pas facile de rentrer dans le réseau. Il faudrait élargir ce réseau, mais j’ai l’impression qu’il s’ouvre un peu actuellement, c’est cool. » On ouvrait cet article avec l’idée que l’émergence, pour un.e musicien.ne, était avant tout un processus, une longue et parfois lente ouverture. Dont acte. Fidel Fourneyron poursuit avec ce souvenir : « Le dispositif évolue avec le temps, j’y ai participé en 2016, il avait déjà bien changé depuis ses débuts. Il continue à mûrir ». Certaines nouveautés vont dans le bon sens comme « le travail d’accompagnement, les journées de formations (comme celles sur le disque, la com’ et les aides par exemple), l’organisation de rencontre avec les professionnel.le.s du secteur ou encore la mise en place de résidences de création rémunérées ».