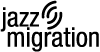La diffusion en ruralité suppose un engagement supplémentaire. Elle repose aussi sur une méthode qui doit sortir de l’opposition stérile urbanité/ruralité. D’une part, les études des profils culturels concordent sur des individus aussi exigeants d’un côté comme de l’autre. D’autre part, parce que les ruralités ne sont pas des territoires isolés mais bien des espaces insérés dans des réseaux aux multiples échelles. La diffusion en milieu rural devrait se saisir des spécificités de la ruralité et des liens politiques, sociaux et écologiques qui la composent.
Par Lucas Le Texier

Alors que le débat politique façonne et cultive la symétrie ville/campagne, la ruralité ne se résume pas à un ensemble homogène de réalités territoriales. Pierre Perrier-Conrat répartit en trois grands types les territoires ruraux en fonction de leur évolution : la campagne « ressource », avec une activité agricole et industrielle encore importante ; la campagne « cadre de vie », à l’activité touristique et davantage résidentielle en périphérie des espaces urbains ; et la campagne « nature », des espaces protégés et valorisés dans leurs dimensions écologique, paysagère et environnementale[1]. Outre ces critères de recherche, les territoires ruraux s’insèrent en réalité dans « de nouvelles logiques systémiques, de réseau, de transition écologique et sociale, de mise en capacité des ressources territoriales[2] ». Revitalisés par la crise sanitaire et par une tendance de fond, celle de la migration d’une population urbaine vers ces territoires, les espaces ruraux portent de nouveaux imaginaires et sont le lieu de nouvelles pratiques, à rebours de l’image d’Epinal d’une ruralité fossilisée et d’une « campagne » immuable. Un chiffre permet de saisir les potentialités des ruralités : en moyenne, un tiers de la population française réside dans un espace rural ; pour certaines régions comme la Bourgogne-Franche-Comté, la Bretagne ou la Nouvelle-Aquitaine, c’est plus de la moitié de leur population[3].
Pour percevoir et interroger cette dynamique, SoFEST! avait dénombré dans son étude Ruralités qu’un tiers des 7300 festivals de France se déroulaient dans des espaces ruraux, la majorité étant des festivals dédiés à la musique[4]. Au-delà de ce constat, l’étude de SoFEST! bataille contre une idée reçue : celle que les publics ruraux seraient moins exigeants que les publics urbains. Les programmations étudiées sur les 3000 festivals de musique de l’étude démontrent l’inverse. Autrement dit, les zones rurales n’ont pas de besoins culturels différents de leurs homologues urbains.[5].
Histoires de réseaux
Les territoires urbains et ruraux continuent d’être représentés comme des mondes étanches [6]. Pourtant, la crise des gilets jaunes a enclenché une rénovation des outils statistiques autour de la ruralité. En 2021, l’Institut national de la statistique et des études économiques proposait une grille communale de densité en sept niveaux, permettant de cartographier plus finement la ruralité. Outre la mise en avant de la diversité des mondes ruraux, cette grille permettait de mieux voir les imbrications, interactions et dépendances entre zones urbaines, périurbaines et rurales.
C’est dans ces logiques que la diffusion du jazz dans les milieux ruraux s’inscrit. Au réseau local, la diffusion en milieu rural suscite la création de partenariats avec les acteur·rices locaux·ales, des bénévoles au·à la restaurateur·rice du coin. Ces liens facilitent l’implantation des structures et, in fine, garantissent leur légitimité. Basé à Mens, le festival Mens Alors illustre déjà ces imbrications de plusieurs territoires à proximité : « On fonctionne au maximum au local. Pour la cuisine, c’est Josselin qui possède le Bistrot de la Place à Clelles, à une vingtaine de minutes, qui balise sa semaine pour le festival. Il nourrit les artistes, les bénévoles avec des produits du coin, midi et soir. Il fait un peu plus pour la vente publique. La bière et les glaces sont aussi locales » explique Thibault Cellier. La démarche est similaire pour Jazz dans le Bocage, qui s’appuie sur les associations locales pour gérer la restauration, la buvette et le prêt de matériel. Ségolène Alex, directrice de Jazzèbre, illustre la richesse de ce réseau sur lequel les diffuseurs peuvent s’appuyer en parlant de l’existant : « C’est important de ne pas arriver en conquérant, avec notre drapeau, de bomber le torse et dire »venez voir, on va faire un super concert ». Il faut sortir de ce postulat et travailler avec ce qu’il se passe dans nos territoires, dans nos petites communes, avec des gens engagés qui ne le sont pas forcément sur nos domaines culturels ». Outre les ressources matérielles, les associations comptent sur les bénévoles, ressources humaines cruciales. La question du renouvellement des bénévoles, constitués d’une majorité de retraité·es contre peu d’actifs et de jeunes[7], est d’ailleurs cruciale pour la ruralité.
Si la valorisation des liens locaux est indispensable, elle ne peut suffire. Les espaces ruraux et urbains s’imbriquent dans leurs infrastructures de transport et flux d’échanges de marchandises, indispensables au bon déroulement de la diffusion rurale. Pour le matériel technique de Mens Alors qui provient de Grenoble. Pour Jazz dans le Bocage, qui fait venir une partie de la technique depuis Clermont-Ferrand voire Tours, et ses technicien·nes de ces mêmes pôles urbains. Un lien évident entre ces deux pôles, ville-campagne, reste les infrastructures de transports qui relient les territoires. Si la voiture reste le principal moyen de locomotion des publics dans ces territoires, les gares desservies par les trains et les bus accueillent une partie de ces mobilités, malgré les difficultés liées à la raréfaction de l’offre ferroviaire et à l’éloignement géographique des gares. Alors que Mens Alors accueille une partie des artistes et de son public en provenance de la gare de Clelles à 15-20 minutes du festival, Jazzèbre a bousculé ses horaires de concerts pour permettre à des festivalier·ères venu·es de Perpignan de faire l’aller-retour en train pour se rendre à Elne. L’association a également un partenariat avec une association et atelier de vélo participatif sur Perpignan, la Casa Bicleta, et propose des départs de Perpignan sur les zones rurales où se déroulent les concerts. « Cela fait une quinzaine d’années qu’il y a une balade organisée au départ de Perpignan pour nos piques-niques. L’année dernière, nous avons commencé à le faire sur d’autres dates comme pour un concert à Thuir, à 25 km de Perpignan quand même. J’y croyais moyennement, mais on a eu une dizaine de personnes qui sont venues et qui ont fait l’aller-retour. On va le développer sur d’autres dates cette année » affirme Ségolène Alex.
Signe de ce réseau partagé entre les villes et les campagnes, la communication de ces concerts qui se diffuse en ville, comme pour Jazz dans le Bocage : « On fait de la communication dans tout le département, mais on fait aussi des campagne d’affichage sur Clermont, dans des magazines, à la radio, en faisant passer des supports papiers là-bas, jusqu’à Nevers. Avec les réseaux sociaux et des actions de communication dessus, on tente aussi de toucher des publics plus jeunes et plus citadins » explique Sabine Dauchat. Ces dynamiques d’échanges et de mobilités sur les territoires se ressentent sur les publics qui sont constitués de ruraux·ales/locaux·ales certes, mais aussi d’un noyau d’urbain·es. Dans l’autre sens, des institutions de ville ayant une programmation en milieu rural, comme la Scène Nationale d’Albi, ont opté pour une communication spécifique vers le monde rural. « Notre communication était liée à l’image de l’institution, très Ligne Roset. Les partenaires nous ont fait un retour, et on a beaucoup travaillé à construire une communication qui n’est pas dans le symbolique, mais plutôt dans l’appel au premier degré. Quelque chose de plus direct, en somme » commente Boris Sommet.
Des publics investis
Cette imbrication de réseaux hétérogènes devrait nous amener déjà à relativiser cette prétendue différence entre les publics urbains et les publics ruraux. Un point souligné par Roger Fontanel : « Nous n’avons pas attendu le plan Ruralité pour travailler en milieu rural. Il peut y avoir des clichés dans ces représentations, alors que les manifestations en milieu rural, si elles ont leurs spécificités, ne sont pas opposées aux initiatives des milieux urbains. En quoi les finalités d’un projet artistique et culturel en milieu rural diffèrent par rapport à celles en milieu urbain ? C’est la prise en compte du territoire qui change, mais la philosophie reste la même ». La sociologie des publics observés abonde en ce sens, avec des publics de la ruralité assez proche des profils types des publics de la culture des français·es. De même, ces publics ne diffèrent pas dans l’exigence des goûts et dans les préférences esthétiques. Pour le formuler comme le ferait l’étude de SoFest, un·e spectateur·rice de jazz en milieu rural ressemblera toujours davantage à son homologue en ville qu’à un·e spectateur·rice de rock en ville et en campagne. Enfin, tout comme les urbains, les “ruraux” placent leurs sorties culturelles au cœur d’un système de relations sociales et familiales. La principale distinction concerne l’importance que les publics ruraux de la culture accordent aux sorties familiales. La raison pourrait être la raréfaction des systèmes de gardes et d’enfants, et l’importance de la sortie dans une offre culturelle amoindrie par rapport aux pôles urbains[8]. Cette importance de la dimension familiale dans les sorties culturelles revêt donc au bouche-à-oreille un rôle central dans cette communication : « Le bouche-à-oreille est très puissant, bien plus que tout le battage médiatique que l’on peut faire sur les réseaux. A partir du moment où les habitant·es du territoire concerné·es font le lien, on aura du monde » développe Claire Devic de Millau Jazz.
Concerner les habitant·es et dépasser la perception d’une activité venue de la ville, voici l’un des enjeux de ces acteur·rices de la diffusion. « Il a fallu apprivoiser les ruraux·ales, celleux qui sont le plus concerné·es par ce travail du territoire, remarque Thibaut Cellier. Celleux qui viennent de Grenoble, c’est parce qu’iels ont déjà repéré qu’il y avait tel ou tel artiste. Dans les villages, beaucoup font du café ou de la bière de façon artisanale et locale. On leur explique que l’on a la même démarche avec la musique que l’on propose ». Clé de voûte dans ce système d’acceptation à l’échelle d’un territoire rural l’investissement des locaux·ales au sein de l’association. « Il faut travailler chaque année pour aller raccrocher les gens, et créer une énergie collective. Ça reste un village de 1500 habitant·es » continue Thibault Cellier.
De la décentralisation à la coopération
Au début des années 1980, l’arrivée de la gauche au pouvoir se traduit par le doublement du budget du ministère de la Culture. Elle se traduit aussi par le passage d’un État tutélaire à un État partenaire qui fait des collectivités locales des acteur·rices des politiques publiques à part entière, actant la naissance des premières conventions entre les pouvoirs publics nationaux et locaux. Symbole de cette décentralisation culturelle, les scènes labellisées se répartissent sur tout le territoire et inscrivent ce nouveau partenariat entre l’Etat et les collectivités locales dans le marbre. Ces structures ont joué et jouent un rôle clé dans l’inscription des questions culturelles dans l’agenda des politiques locales. Mais les enquêtes sur les pratiques culturelles ont aussi pointé un échec dans le maintien de barrières matérielles, sociales et symboliques pour l’accès à la culture « légitime » [9].
Cette histoire des politiques culturelles en France va de pair avec un modèle français qui légitime fortement l’intervention de l’Etat[10]. Une logique aujourd’hui mise à mal dans cette décentralisation perçue comme une logique descendante et unilatérale. En 2009, le rapport de la Fédélima pointait en ce sens, les limites des partenariats entre les collectivités et les lieux de musiques actuelles impulsés par des « chefs de file » urbains[11].
L’utilisation de ce terme “décentralisation culturelle” pose aujourd’hui débat, comme l’évoque Boris Sommet de la Scène Nationale d’ALBI-Tarn : « Même si la décentralisation nous a fait naître, nous n’utilisons plus ce terme car il y a le côté descendant de l’institution, qui capte la majorité des deniers du Département et de la ville. Au moindre faux pas, les partenaires associatifs et communes ne nous ratent pas. Notre nouvelle direction a voulu renouer un dialogue sur l’offre artistique qui, dans notre cas, avait complètement disparu. Sans ça, nous n’aurions pas pu sortir de la position du sachant et de la logique descendante qui était en œuvre jusqu’alors ». Cette logique descendante est d’autant mal perçue par la majorité des “ruraux·ales” qui ont le sentiment que leur commune est abandonnée par les pouvoirs publics[12].
Dans ces logiques de co-construction, impliquer directement les habitant·es dans la diffusion des concerts paraît être une bonne piste. Comme lorsque le festival Mens Alors organisait des concerts dans les jardins des locaux. Une initiative similaire a été portée par Didier Levallet et l’équipe de Jazz Campus en Clunisois : « On s’est aperçu que c’était toujours notre public qui nous suivait quand on allait faire des concerts dans d’autres communes, et que les locaux·ales n’y allaient pas. Depuis quatre ou cinq ans, on a institué des concerts chez l’habitant·e, en prenant précaution de ne pas aller chez des personnes qui vont déjà à nos concerts. Le message est le suivant : invitez vos ami·es, vos voisin·es et on vous offre le concert. Ce sont des artistes de la programmation estivale qui se produisent en solo » explique Didier Levallet. L’association Jazzèbre propose des formats « piques-niques », manière d’éviter un concert sec et d’impliquer les publics pendant une journée. « Le rendez-vous est pris dans la matinée, où on propose une balade qui met en avant le patrimoine naturel et historique en comptant sur des associations qui travaillent déjà sur ces questions. Il peut y avoir des moments de musique, avec les artistes qui ont joué la veille ou qui joueront le soir-même » explique Ségolène Alex.

Une tarification rurale ?
Les concerts ont un coût, et la pédagogie en ce sens auprès des publics est importante. Didier Levallet, directeur du Cluny Jazz Festival parle « d’offrir » le concert, et non de gratuité simple, et « à travers cette notion d’ »offrir » un concert, on sous-entend qu’il y un coût, et ce coût est relativement important » insiste Pascal Buensoz de Jazz(s)Ra.
Cette question du coût rejoint entre autres celle de la tarification et de la billetterie. Les adhérents AJC pratiquent une politique tarifaire parmi les plus abordables dans les esthétiques jazz, blues et musiques improvisées, signe d’un fort engagement des diffuseurs du réseau. Si la tarification relativement homogène au sein du réseau pour les acteur·rices opérant en milieux urbains et ruraux, les prix restent légèrement plus élevés au sein de la ruralité[13]. Rappelons-nous ici que l’itinérance de la diffusion en milieu rural sollicite souvent davantage les structures, notamment en termes de déplacements d’artistes, de matériel et d’équipes techniques. La billetterie, qui compte pour 20 à 35% des produits de ces structures en milieu rural, est d’autant plus cruciale que ces acteur·rices sont souvent moins subventionné·es que leurs homologues en milieu urbain. Enfin, la billetterie prend une place de plus en plus importante dans un contexte de baisse des subventions. La grille tarifaire légèrement supérieure pour les diffusions en milieu rural apparaît moins comme une spécificité de la ruralité que comme une adaptation à son territoire. Connaître son territoire, c’est pratiquer une tarification juste.
Si certaines structures ont une grille tarifaire spécifique pour les concerts hors-les-murs comme la Scène Nationale d’ALBI-Tarn, d’autres à l’instar de D’Jazz Nevers ont un tarif unique de saison pour Nevers et le milieu rural. Les festivals Mens Alors et Jazz dans Le Bocage proposent plusieurs tarifs, avec des options de tarifs réduits et des pass de plusieurs jours. L’aménagement d’une grille tarifaire pour les précaires, jeunes, RSA, etc. est d’autant plus importante que les niveaux de vie sont plus bas dans le rural isolé que dans les banlieues et communautés périurbaines[14]. La bonne fréquentation confirme aux deux festivals la justesse de ces différents tarifs.
L’association Jazzèbre articule le prix de ses concerts aux dynamiques des lieux : « Si pour une commune, c’est dans leur habitude de faire des spectacles le samedi matin et que le billet est à 5 euros, on va naturellement s’inscrire dans cette logique. On ne revendique pas la gratuité, on choisit plutôt d’avoir un prix extrêmement modéré. Pour les tournées, on est principalement en gratuité car les communes en sont plus souvent friandes. Elles choisissent alors de mettre l’apport financier nécessaire » complète Ségolène Alex.
A rebours d’une opposition binaire entre des espaces urbains dynamiques et des territoires ruraux dépeints « comme des zones de relégation mortifères au sein d’une France périphérique grandissante[15] », les villes et les campagnes s’insèrent déjà dans des réseaux communs. Visibles par les mobilités des publics et des artistes, ou par les flux de matériels, ces liens s’affichent aussi dans les zones d’action des établissements et structures culturel·les des villes qui se déploient dans un rayon plus grand que leur périmètre habituel. Le chemin à suivre de la co-construction et de la coopération, modèle promis et promu par la décentralisation culturelle, semble aujourd’hui devoir se réinventer.
La réponse ne résiderait pas tant dans une offre culturelle pour des publics ruraux qui seraient différents de leurs homologues urbains. Elle tiendrait plutôt dans une démarche collaborative entre acteur·rices politiques de l’État, professionnel·les de la culture et élu·es/habitant·es locaux·ales pour la diffusion du jazz et des musiques improvisées, autour de trois points : des instances de discussion communes et horizontales, l’implication du local (espaces patrimoniaux/naturels, produits « du terroir », associations, bénévoles, locaux·ales), et l’insertion de l’offre culturelle dans les sociabilités et habitudes des différentes ruralités.
[1] La Fédélima (La Fédurok), Les lieux de proximité de musiques amplifiées/actuelles : l’exemple du milieu rural, 2009, p. 10. URL : https://www.fedelima.org/IMG/pdf/etude_2008.2009_milieu_rural.pdf
[2] « Ruralité(s) », Culture et ruralité. URL : https://cultureruralite.fr/ruralites/
[3] Julien Audemard, Aurélien Djakouane, Edwige Millery, Emmanuel Négrier, Ruralités, Etude SoFEST! éditée par France Festivals, 2024, p. 6. URL : https://www.francefestivals.com/media/francefestival/189240-ff_sofest__ruralite_s-4.pdf
[4] Ibid.
[5] Ibid, p. 5.
[6] Ibid.
[7] Mission de Cyril Cibert sur la vie associative en ruralité, 2024. URL : https://www.cyrilcibert.fr/
[8] Julien Audemard, Aurélien Djakouane, Edwige Millery, Emmanuel Négrier, Ruralités, Etude SoFEST! éditée par France Festivals, 2024, p. 48. URL : https://www.francefestivals.com/media/francefestival/189240-ff_sofest__ruralite_s-4.pdf
[9] Philippe Poirrier, « Un demi-siècle de politique culturelle en France », Diversité, 148, 2007, pp. 15-20.
[10] La Fédélima, Les lieux de proximité de musiques amplifiées/actuelles : l’exemple du milieu rural, 2009, p. 43.
[11] Philippe Poirrier, « Décentralisation culturelle » et vie intellectuelle en Région », 2016. URL : https://ube.hal.science/hal-01495869/
Philippe Poirrier, « Le mythe de la décentralisation culturelle », 2002. URL : URL : https://ube.hal.science/hal-01540337/file/Le_mythe_de_la_decentralisation_culturel.pdf
[12] AJC, Enquête. Les structures de diffusion du jazz en France, 2016, p. 27. URL : https://ajc-jazz.eu/wp-content/uploads/2018/11/181105-ajc-def-digital.pdf
[13] Observatoire des inégalités, « Ville, périurbain, campagne : qui est riche, qui est pauvre ? », 2025. URL : https://www.inegalites.fr/Ville-periurbain-campagne-qui-est-riche-qui-est-pauvre
[14] Clément Reversé, « Une pauvreté invisible des jeunes en milieu rural ? », The Conservation, 19 février 2024. URL : https://theconversation.com/une-pauvrete-invisible-des-jeunes-en-milieu-rural-223041
[15] Julien Audemard, Aurélien Djakouane, Edwige Millery, Emmanuel Négrier, Ruralités, Etude SoFEST! éditée par France Festivals, 2024, p. 3. URL : https://www.francefestivals.com/media/francefestival/189240-ff_sofest__ruralite_s-4.pdf