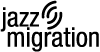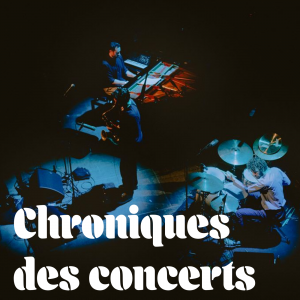Alors que les territoires ruraux constituent 88% du territoire hexagonal et abritent 33% de la population française, comment faire rimer diffuser avec ruralité ? Panorama des initiatives et portraits de quelques acteur·rices qui diffusent le jazz dans les « campagnes ».
Par Lucas Le Texier

Caricaturée comme un espace champêtre, déconnecté et nostalgique, la ruralité recouvre de nombreuses réalités parfois fort différentes. Il n’y aurait pas une mais des ruralités, dont les acteur·rices dressent un panorama selon les caractéristiques de la leur : un territoire sans équipement technique ou infrastructures ; une zone géographique paradoxalement, entre attraction et repoussoir vis-à-vis de la métropole toute proche ; une communauté de communes de quelques villages ; des espaces difficiles d’accès. A leur échelle, les acteur·rices de la diffusion du réseau AJC illustrent, par leur identité ou les zones de diffusion qu’iels investissent, ces différentes expériences. Iels nous offrent même une échelle pour les observer. Le festival Mens Alors dans la commune éponyme en Isère (400 habitant·es) ; Jazz Campus en Clunisois qui essaime sur la communauté de communes de Cluny (5000 habitant·es), Jazz dans le Bocage au sein du Bocage Bourbonnais et Tronget (1000 habitant·es), sa place forte. Viennent ensuite des ruralités plus denses, celle couverte par Jazz à Luz depuis son fief du même nom (900 habitant·es) jusqu’à 64 petits villages alentour dans un territoire de montagne. Pour certain·es, la ruralité se déploie au pluriel, née de l’itinérance des programmations, comme celle de Millau en Jazz qui partage les concerts et actions sur son fief (20 000 habitant·es) et sur les petits villages du territoire aveyronnais. Même constat pour Jazzèbre qui travaille à l’année avec une vingtaine de communes sur l’ensemble du territoire des Pyrénées-Orientales. Enfin, la ruralité peut aller de soi : dans un département comme celui de la Nièvre, c’est l’ensemble du territoire qui apparaît pour D’Jazz Nevers, l’incarnation même de cette ruralité.
La diffusion en ruralité est une pratique à part entière, qui doit se penser avec les territoires et les individus qui les constituent. Loin d’être une réplique rurale d’une diffusion en milieu urbain et périurbain, l’itinérance suit ses propres logiques. Comme le résumait Pascal Buensoz du réseau Jazz(s) Ra, « elle sollicite davantage » dans de nouvelles dynamiques avec les artistes, les élu·es, et les mobilités.
Pratiques de la diffusion en milieu rural
Incarnant en partie le centre de l’animation culturelle dans les milieux ruraux, la salle des fêtes est elle aussi investie par les réseaux de diffusion du jazz, réaménagée selon les exigences artistiques et techniques. Comme à Mens Alors, Millau en Jazz occupe ce type d’espaces. « Les principales difficultés consistent en l’aménagement des salles des fêtes pour que les personnes se retrouvent comme dans une salle de spectacle. Pour moi, la ruralité, c’est aller dans ces endroits à faible densité humaine pour proposer des concerts et se sentir comme si on était dans une salle qui y était dédiée » explique Claire Devic. Reste que les lieux et expérimentations peuvent se démultiplier à l’infini selon les territoires et leurs spécificités : foyers ruraux, écoles, églises, stations de ski, librairies, mairies, brasseries, places publiques…
Il faudrait se nourrir des énergies sur place, alors ? « Souvent, on se rend compte qu’il se passe des choses avec un·e acteur·rice militant·e sur un territoire particulier, pas forcément sur le culturel, mais avec une envie de rassembler. Ce sont ces gens que l’on va chercher pour travailler » explique Ségolène Alex de Jazzèbre. Si les petits (et parfois atypiques) lieux peuvent facilement être exploités par Jazzèbre, à la programmation itinérante, acoustique et en forme réduite, se passer des pôles urbains reste complexe pour les diffuseurs dont le QG se trouve dans les mondes ruraux. Notamment pour les besoins techniques. « Pour le festival, on a deux semis qui viennent de Grenoble, avec toute la technique pour la semaine. C’est comme ça qu’on rhabille la salle polyvalente et que l’on a l’impression de se retrouver dans une salle de spectacle » confie Thibault Cellier de Mens Alors. Pour d’autres, comme Jazz dans le Bocage, il s’agit d’un modèle plus hybride, qui dépend essentiellement des concerts programmés : « Notre prestataire technique est sur Clermont-Ferrand, et une partie de l’équipe technique son et lumières vient de là-bas aussi. On travaille de plus en plus sur de la location de backline au niveau local ou proche, mais pour les demandes particulières, on peut aller même jusqu’à Tours » précise Sabine Dauchat. Des questions techniques tissent déjà des rapports moins frontaux entre villes et campagnes. La technique est peut-être l’une des différences entre des structures de diffusion localisées dans la ruralité, et les scènes en milieu urbain. « Dans nos tournées hors-les-murs, ce sont essentiellement des petits villages. On a une vingtaine de partenaires qui nous ont délégué la programmation et la technique. La Scène Nationale vient équiper leurs lieux pour accueillir des représentations » commente Boris Sommet de la Scène Nationale d’ALBI-Tarn.
Les élu·es et nous
Les pouvoirs et communautés publics, ainsi que les acteur·rices culturel·les comme les écoles de musique ou les centres sociaux, sont des points d’entrée privilégiés pour la pénétration des territoires ruraux. « Le projet de D’Jazz Nevers a été développé comme une action de décentralisation culturelle. Il se poursuit en nouant des liens forts avec les partenaires publics autour de conventions qui bâtissent des projets et des actions autour. Ça peut être des interventions ou des résidences d’artistes » explique Roger Fontanel pour D’Jazz Nevers. Il y a la crainte d’une remise en cause d’un pacte politique entre les acteur·rices culturel·les et les élu·es à la culture. « Je suis inquiète de cette habitude que l’on voit se développer chez les élu·es de la culture. Certain·es ont le sentiment d’être là pour faire la programmation alors que pour moi, ils doivent avant tout faire le lien avec les acteur·rices de leur territoire. Définir une orientation culturelle certes, mais faire confiance ensuite et permettre aux acteur·rices culturel·les de travailler » réagit Ségolène Alex de Jazzèbre. Cette question de l’implication des élu·es illustre comment la diffusion en ruralité impose un nouveau rapport entre les diffuseurs et le reste des acteur·rices. Vis-à-vis des élu·es, il implique un travail de terrain, de proximité et de pédagogie que résume Olivier Large pour Parfum de Jazz : « En milieu rural, le concept de culture ainsi que le coût de cette dernière ne sont pas toujours bien compris ».
Autre problème de ces liens dans la ruralité, le vieillissement global des populations et donc des élu·es qui peut fragiliser ces bonnes ententes « On a le sentiment dans le Tarn d’un retour en arrière sur la nécessité de porter une saison artistique et culturelle. A la différence du contexte urbain, l’impulsion vient d’une ou deux personnes, bénévoles, plutôt âgées, et donc à bout de souffle. D’où notre interrogation : avec le renouvellement prochain des conseils municipaux, comment ces partenariats vont-ils évoluer ? » déclare Boris Sommet. Le tableau n’est pas si sombre partout, comme à Mens Alors, où la mairie, le département et la région poursuivent leur accompagnement du festival. « C’est un peu ce qu’ils voulaient renforcer » remarque Thibault Cellier. Pour Jazz dans le Bocage, les liens sont très forts entre l’équipe de la communauté de communes du Bocage Bourbonnais et le festival. Sabine Dauchat tient cependant à garder des réunions officielles avec tous les partenaires : « Quand on a des choses à dire, ce n’est pas toujours l’idéal cette proximité. Je tente de mettre en place des réunions qui ont lieu tous les deux ans, avec l’ensemble de nos partenaires publics. C’est important que la communauté de communes, qui nous soutient totalement, puisse côtoyer des interlocuteur·trices, comme la conseillère musiques actuelles de la DRAC qui valide notre projet. Ça permet aux élu·es de se dire qu’il y a de la qualité et de la pertinence, vu qu’iels n’ont pas forcément les compétences techniques pour l’apprécier » selon Sabine Dauchat.
Bien que tous les feux soient au vert pour que cette collaboration continue, elle reste fragile avec la perspective d’un changement de majorité aux prochaines municipales. L’opposition est plus réticente à cette collaboration, et compliquerait l’accomplissement du projet de Jazz dans le Bocage. « Nous sommes soutenu·es par d’autres partenaires du même bord qu’elleux, mais au niveau local, ce serait sans doute plus complexe, comme pour la mise à disposition de matériel, des choses où on avance simplement vu notre niveau de confiance mutuelle », poursuit Sabine Dauchat. L’itinérance permet de minimiser ces risques liés aux changements d’équipes municipales, comme pour Jazzèbre. « Sur les quinze-vingt communes avec lesquelles on travaille, certains partenariats se détissent, on a cette liberté de pouvoir le faire. Quelquefois, l’inverse se produit : des changements d’équipes font en sorte qu’on revienne nous chercher » explique Ségolène Alex de Jazzèbre. En tant qu’animateur de réseau, Pascal Buensoz de JAZZ(s)RA insiste sur les rencontres professionnelles de la structure pour réunir les acteur·rices. Le dernier forum du réseau intitulé « Musique en ruralité », le 11 mars 2025 à Saint-Jean-de-Bournay, a ainsi permis de réunir les professionnel·les du jazz avec des élu·es, technicien·nes et représentant·es des collectivités qui sont souvent absent·es des autres rendez-vous du secteur.
Monter et tournées
Les partenariats de longue date établis avec les acteur·rices ruraux·ales (D’Jazz Nevers) ou les missions d’une Scène nationale (Albi Tarn) créent des habitudes et permettent de faciliter la diffusion en milieu rural. Mais la continuité de celle-ci n’est jamais acquise et demande aux diffuseurs des échanges réguliers pour convaincre les élu·es et les tutelles de la pertinence de leur projet. « Moi, je fais le boulot de booking et de chargée de diffusion. Sur le territoire, c’est nous qui faisons le démarchage auprès des communes, avec cette idée de convaincre par rapport aux esthétiques que l’on présente » lance Ségolène Alex pour Jazzèbre. Et ne pas hésiter à aller sur place comme pour Millau en Jazz. « Quand on va voir les politiques, on prend le bâton de pèlerin. Il faut aller les rencontrer, habitant·es et élu·es des villages, parce que l’humain est très important dans ce genre de relation. », complète Claire Devic.
A l’échelle d’un village comme Mens, le temps et les bonnes conditions d’accueil font leurs effets. « On a une salle où on fait trois soirées, avec 400 personnes. On fidélise le public, malgré le fait que 80 à 90% des gens ne connaissent pas la programmation » conclut Thibault Cellier de Mens Alors. Même démarche du côté de Jazz à Luz qui installe un chapiteau pendant la durée du festival. Pour Jazz dans le Bocage dans le Bocage Bourbonnais ou Parfum de Jazz dans la Drôme provençale, les concerts se partagent la plupart du temps entre un chef-lieu et les villages alentour. « C’est nous qui nous déplaçons dans les villages pour aller organiser des concerts au plus près des publics » ajoute Olivier Large pour Parfum de Jazz. Idem pour Jazz Campus en Clunisois, qui organise chaque année une quinzaine de concerts à Cluny et dans le Clunisois. Il se dégage surtout des logiques propres à la diffusion au sein de ces mondes ruraux, comme l’importance de monter des concerts avec des structures et des acteur·rices sur le territoire. « Sur un village de 1500 habitant·es, les partenariats ne sont pas multiples. Par exemple, on ne peut pas exclure le camping. On a un arrangement avec eux, avec des artistes qui viennent en famille, sur une programmation off et faite pour que les gens se croisent. Le festival impulse une énergie : c’est un partenariat où l’on place des propositions en fonction de l’environnement » explique Thibault Cellier pour Mens Alors. Si l’idée du camping peut faire sourire, quid des concerts en stations de ski proposées par Jazz à Luz ? « Notre objectif, c’est de savoir comment diffuser en milieu rural, dans des endroits non dédiés. C’est une manière aussi de réinventer ces espaces ruraux là, qui vont sans doute se transformer pour des raisons écologiques » décrit Karine Peignaud de Jazz à Luz. Plus encore, ne pas faire un concert « sec » comme précise Olivier Large, mais miser sur la convivialité : « La convivialité nous paraît essentielle. Contrairement en ville où on peut aller boire un verre ensuite, il me semble important qu’il y ait une buvette ou un pot offert ».
Les initiatives en éducation artistique et culturelle (EAC), en complément des concerts et d’une diffusion plus « classique », participent à nourrir les liens entre les artistes, les professionnel·les et les territoires ruraux. Un cercle vertueux qui intéresse les élu·es ruraux·ales, notamment celleux qui cumulent les responsabilités. « Les élu·es qui sont en charge des dossiers culture dans les communautés de communes sont aussi en charge des associations, du côté sportif, de la cohésion des territoires… C’est intéressant quand on travaille sur le tissage du lien entre les publics et les artistes » partage Karine Peignaud de Jazz à Luz. Les EAC étant perçues comme un véritable outil pour approcher la ruralité, l’agence région Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant réfléchit à un outil en ce sens, Myriade, co-financée par la Drac et la Région. « Myriade cartographie toutes les initiatives en termes d’éducation artistique et culturelle (EAC) qui sont financées ou cofinancées par l’Etat, la Région ou les communautés de communes. On répond à un manque, car on connaît bien les projets de diffusion que l’on porte mais ces EAC manquent souvent de visibilité. Ça permet aussi aux musiciens de savoir ce qui se fait dans nos territoires, et d’être force de proposition » note Pascal Buensoz de Jazz(s)Ra.
Enjeux et limites des mobilités douces
Impulsés en France par Le Périscope et AJC, les projets autour de la décarbonation du monde musical ont interrogé, si ce n’est déjà transformé, les pratiques de la part des professionnel·les[1]. Comme pour l’île de la Réunion qui cumule les spécificités[2], les espaces ruraux ont les leurs. Sensibilisées aujourd’hui aux enjeux de décarbonation, les acteur·rices de la diffusion contribuent déjà à baisser l’empreinte carbone des transports des artistes par les tournées et le rapprochement des dates. Le déplacement des publics, premier poste de dépenses carbone, reste complexe. Les villes disposent d’un réseau de transports en commun, contrairement aux milieux ruraux comme le résume Sabine Dauchat pour son festival dans le Bocage bourbonnais : « Il y a très peu de transports en commun sur ce territoire, et pas du tout en soirée ». Même constat pour le Département de la Nièvre du côté de D’Jazz Nevers. De l’ensemble des acteur·rices qui l’ont mis en place, le constat est unanime sur les plateformes de covoiturage mises en place par les professionnel·les : elles ne fonctionnent que trop peu.
Alors, sur quoi influer ? Les acteur·rices de la diffusion ont souvent peu de moyens pour peser sur l’offre des transports en commun qui dépendent la plupart du temps surtout d’échelles politiques. Pour peser dans la balance, il faut du collectif. « A l’échelle du département Pyrénées-Orientales, nous faisons partie du collectif écho(s) qui réunit 11 festivals associatifs, dont beaucoup en milieu rural. On est en train de faire des rencontres avec la SNCF et les opérateurs publics de transport du Département pour tenter de mutualiser et d’avoir une voix plus forte » évoque Ségolène Alex. Repenser aussi ces pratiques de diffusion pour encourager une diffusion plus verte, parfois à l’encontre des espaces offerts par la ruralité. « Il y a quelques années, nous avions fait un concert dans une grange perdue dans la montagne. On s’est retrouvé·e avec 200 ou 250 voitures venues pour écouter un concert magnifique certes, mais ça nous a posé un cas de conscience. Depuis, nous n’avons pas renouvelé l’expérience au grand dam de nos festivalier·ères, mais aussi pour rester cohérent·es » explique Karine Peignaud pour Jazz à Luz. La solution des tournées en vélo, exploitées par Jazzèbre ou Jazz dans le Bocage, constituent des alternatives sur des temps particuliers.
Faire co-exister diffusion en milieu rural et enjeux écologiques est rendu encore plus complexe si à l’instar de la région Occitanie, « on conditionne ses aides sur les questions des mobilités du public. Pourtant, ce qui reste aberrant à Albi, c’est qu’on peut partir de la ville pour aller aux représentations ailleurs en région, mais on ne peut pas y rentrer une fois que c’est terminé » se désole Boris Sommet de la Scène Nationale Albi-Tarn. Les mobilités des publics, plus grosse partie du bilan carbone de la diffusion du spectacle vivant, s’ajustent en fonction des jauges des concerts comme à Parfum de jazz : « On peut diffuser dans des petits villages quand on compte sur 50-150 personnes, mais dès qu’on fait des concerts qui accueillent 300 ou 500 personnes, on doit se replier sur des infrastructures plus grosses. Et c’est là que le problème de mobilité du public se pose » ajoute Olivier Large.
Comment l’itinérance nous sollicite davantage ? La diffusion en milieu rural est un pas de côté, qui plus est, aux exigences supplémentaires. Elle ne peut se faire l’économie d’un travail de terrain qui implique collectivement les locaux, les élu·es et les écosystèmes. Tout à la fois factrice et dépendante des liens sociaux, cette diffusion se déploie comme un objet classique ET augmenté avec des projets de médiations, d’EAC et de valorisation des terroirs. Les enjeux qui transcendent la simple diffusion, tels les questions de décarbonation, sont aussi partagés en zone rurale. La diffusion en milieu rural nécessite des adaptations : convaincre artistes, populations et élu·es ; aménager de nouveaux espaces ; et diffuser dans l’écrin d’un territoire nouveau avec ses propres spécificités.
[1] Renvoi vers l’article sur la diffusion internationale
[2] Renvoi vers l’article sur la diffusion à la Réunion