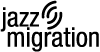La pratique musicale est l’une, si ce n’est la, principale discipline artistique exercée par les habitant.e.s des Outre-Mer. Pourtant, c’est l’une des moins structurées au niveau des politiques publiques. Julie Abalain, responsable du développement et des productions à Tropiques Atrium, la scène nationale de la Martinique, dresse un long constat repris par l’ensemble des intervenant.e.s : « La pratique musicale est inscrite dans la vie quotidienne, avec des familles entières de musiciens et des transmissions générationnelles. Cependant, au regard de la proportion du nombre de musiciens présents sur le territoire, très peu deviennent intermittents ». Même son de cloche en Guyane, où Céline Delaval, conseillère spectacle vivant de la DAC Guyane, confirme ce décalage. Les conditions structurelles peuvent rendre difficile l’exercice professionnel des musicien.ne.s : le manque de lieux de diffusion et de production, notamment pour faire des résidences. En Guadeloupe, Laurence Maquiaba du festival Éritaj, Mémoires Vivantes, doit pallier par son évènement la quasi-absence de structures permettant une résidence de création de longue haleine. La Réunion est quant à elle l’île la plus compatible avec les institutions culturelles métropolitaines, mais Niv Rakotondrainibe, administratrice de production du Séchoir, reconnaît que les musicien.ne.s, une fois professionnel.le.s, manquent d’accompagnement pour vivre sur l’île.
Si la professionnalisation des musicien.ne.s reste l’un des principaux enjeux, la formation initiale plus ou moins institutionnalisée est présente dans les départements ultramarins. À La Réunion, la présence du seul conservatoire régional des Outre-Mer et d’une école de musique actuelle (EMA) à Saint-Leu facilite l’entrée dans la formation musicale. En Martinique, outre les nombreuses écoles de musiques associatives, l’option musique du Lycée Schoelcher est une porte d’entrée efficace pour les néo-musicien.ne.s ; les anciens jazzmen passés en son sein comme Xavier Belin ou Maher Beauroy y réinterviennent régulièrement. Eddy Compper, directeur du Centre culturel de Sonis, lieu qui gère la formation artistique et l’accueil de concerts en Guadeloupe, a signé il y a peu une convention avec les pouvoirs publics et la communauté d’agglomération locale Cap Excellence. Celle-ci enclenche un processus de labellisation plus officielle pour son centre, le rapprochant d’un conservatoire d’agglomération. Partenaire de l’Éducation nationale, le Centre culturel de Sonis accueille l’option Théâtre-Musique-Danse (TMD) qui permet de préparer un bac technologique spécialisé dans les disciplines artistiques.