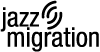Jazz Migration : Perspectives sur l’impact Carbone des mobilités
En 2022, dans le cadre du projet Footprints Le Périscope et AJC publiaient une étude intitulée : Quel impact Carbone pour les lieux et festivals

Voici deux terrains de jeu emblématiques du jazz français. Plus ou moins près, plus ou moins loin de Paris, c’est selon. Deux territoires où l’histoire du jazz remonte à loin mais diffère, à l’ombre ou dans la foulée de deux très grands festivals de jazz, par l’aura et par la taille. Deux exemples à scruter pour en saisir les ressemblances comme particularités d’une « émergence d’une scène jazz » en région.
Regards croisés avec :
Jean-Philippe Birac – Radio Campus Toulouse
Matthieu Cardon – Les Productions du Vendredi
Jean-Pierre Layrac – Jazz à Luz & Un Pavé dans le
Jazz Philippe Metz – École Music’Halle
Fanny Pagès – L’Astrada Marciac
Loris Pertoldi – Le Taquin
&
Jean-Marie Bellec – Conservatoire de Nantes
Loïc Breteau – Association Culturelle de l’Eté – les Rendez-vous de l’Erdre
Guillaume Hazebrouk – Compagnie Frasques
Michel Hubert – Pannonica
Armand Meignan – Le Mans Jazz & les Rendez-Vous de l’Erdre
Frederic Roy – Association Kiosk
Caroline Thibaut-Druelle – Pannonica / Musiques et Danse
La question abordée dans ce numéro 2 de Jazz Mig Mag prolonge celle de « la scène émergente » traitée dans le numéro 1. Nous nous intéressons cette fois-ci à l’émergence d’une scène jazz sur un territoire donné. Vous êtes chacun.e et tou.te.s des acteurs et actrices important pour le jazz à Toulouse et à Nantes. Etes-vous conscient.e.s de participer à la vie et au développement d’une scène jazz locale ? À quel moment peut-on dire qu’une telle scène existe, qu’est-ce qui la fonde et la structure ?
Philippe Metz – Music’Halle : Je mets les pieds dans le plat, on me connait. Déjà être le local de l’étape, ça me gave. C’est une vue parisienne de dire qu’il y aurait un son à tel ou tel endroit. Mais, en même temps, quand on joue depuis Marseille, Uzeste ou Toulouse, peut-être que ce n’est pas complètement pareil. Est-ce qu’il y a un son toulousain ? Il y a une histoire et une vie toulousaine, on est proche de l’Espagne et d’endroits qui sont de grosses influences.
Jean-Pierre Layrac – Jazz à Luz & Un pavé dans le jazz : Je ne sais pas si on peut parler de jazz toulousain. En revanche, ce qui est important c’est de savoir qu’il se passe beaucoup de choses autour des musiciens à Toulouse, et c’est quelque chose qu’on entretient tous. C’est important qu’il y ait une émergence autre qu’à Paris. On est tous acteurs là-dessus et on est très fiers lorsqu’un groupe toulousain arrive à être reconnu nationalement.
Philippe Metz : À un moment donné, il y a eu un Tonton Salut, après il y a eu un Marc Démereau. Tous ces gens-là, effectivement, on les a accompagnés. On a été des accélérateurs de leurs propositions. Oui, il y a une scène jazz toulousaine, bien sûr ! On en fait partie, on la promeut, on l’accompagne, on la défend. Du fait de ces personnalités, du fait qu’on aime la castagne, quoi ! Y a une espèce de chaleur, y a une ambiance.
Loris Pertoldi – Le Taquin : Je pense qu’on est tous conscients d’être des acteurs importants du jazz toulousain. Nous avons repris le Taquin parce qu’il y avait un vivier jazz énorme à Toulouse. Comme dit Philippe, on a affaire à des musiciens qui portent une histoire et qui la défendent.
Matthieu Cardon – Les productions du vendredi : Je dirais qu’il y a une scène qui est composée de différentes familles de musiciens. Pulcinella, Ferdi (Ferdinand Doumerc, ndlr) qui fédère plusieurs aventures autour de lui, tu parlais tout à l’heure de Marc Démereau, on peut citer Freddy Morezon qui représente un peu une autre scène et une autre couleur musicale. Cette scène est faite de plusieurs sous-écosystèmes.


Armand Meignan – Le Mans Jazz & RDVE Nantes : Effectivement on peut parler de scène nantaise, parce qu’on a tous les ingrédients, qui permettent à une scène de vivre.
Un festival, un club, des scènes conventionnées qui programment du jazz, le projet Jazz en phase, lancé par Les Rendez-vous de l’Erdre avec les scènes du département. Ce projet n’est peut-être pas concevable dans d’autres villes que Nantes. Mais l’ambition d’un musicien ne doit pas être uniquement de vivre de sa musique dans son département.
Il faut des structures qui lui donnent l’occasion de créer et de se présenter à des pros et à un large public. Ensuite, ils peuvent espérer jouer ailleurs, voire atteindre une carrière internationale. Ce qui fait la particularité de la scène nantaise, c’est aussi son histoire. Il y a toujours eu ce mouvement avec des projets de jazz. Des festivals comme celui des frères Jalladot. Cela permet de comprendre la scène actuelle.
Guillaume Hazebrouk – Compagnie Frasques : Je pense qu’il y a une scène nantaise et qu’elle existe parce qu’il y a des écoles de musique sur l’agglomération et un conservatoire très actif. Il y a un club, plusieurs festivals, c’est ce qui fait la scène.
Je peux parler de ce qui s’est fait depuis le milieu des années 90. Il y a eu de vraies politiques culturelles, l’arrivée des SMAC. En 1998, le Pannonica est l’une des premières SMAC. Une structuration se fait et favorise l’élaboration de la scène nantaise. Kiosk en est la dernière émanation, ça existe parce que la scène nantaise existe depuis longtemps.
Jean-Marie Bellec – Conservatoire de Nantes : À Nantes, il y a un club officiel, sponsorisé par les institutions, disons. Mais il y a aussi les cafés, dans lesquels les concerts ont beaucoup d’importance. Le Coton-club, qui a fermé, était très important pour le développement du jazz. L’état des lieux de 2013, sur la scène nantaise, est très instructif. Je pense que chez nous aussi, c’est une affaire de personnes qui font marcher les institutions.
Et selon la personne qui est à la tête, ça marche ou pas. Le jazz a pris de l’ampleur au moment où Musique et Danse, qui s’appelait L’association du Département pour le Développement de la Musique, a lancé un stage en 1985. Ça répondait à une très forte demande. Ce stage a été fantastique, il est mort de sa belle mort en 2004, parce qu’il n’était plus nécessaire : il y avait des classes de jazz dans toutes les écoles de musique quasiment. Ce stage n’aurait pas pu avoir lieu sans Yves de Villeblanche, qui a fait énormément. Les Rendez-vous de l’Erdre dépendent aussi beaucoup du programmateur. Quand Armand est arrivé, tout a changé. Même chose pour le Conservatoire. La classe de jazz a été fondée en 1997. Ça a très bien marché jusqu’en 2010. Plein de projets, d’élèves et de projets sur la scène locale. La dynamique s’est arrêtée progressivement entre 2008 et 2010. Plus aucune action avec les partenaires.
Guillaume Hazebrouk : Longtemps, ce qui m’a manqué, c’est la question du maillage, des liens entre les structures. Des structures d’enseignement qui ne fonctionnent pas main dans la main avec les structures de diffusion, ça forge un manque. Ces dernières années, ce n’était pas le cas. Je pense au lien entre le Conservatoire et le Pannonica, qui manquait de fluidité. Et de débouchés pour les jeunes musiciennes et musiciens et donc d’espace pour se projeter et pouvoir avoir envie de rester sur le territoire. J’ai longtemps habité à Tours. Il y a beaucoup d’espaces de circulation de la musique.
Caroline Thibaut-Druelle – Pannonica / Musiques et Danse : C’est vrai qu’il y a aussi des musiciens qui jouent beaucoup partout, et qu’on revoit très peu en Loire- Atlantique. C’est dommage, et c’est pour ça aussi que la question du maillage est très importante.
Il y a les scènes spécialisées mais aussi tout l’écosystème des cafés- concerts, des scènes en milieu rural, pluridisciplinaires, dans lequel le jazz doit aussi trouver sa place. Ces lieux doivent fédérer, pour créer les rencontres.
Loïc Breteau – Association Culturelle de l’Eté : Le jazz a toujours été présent à Nantes. Effectivement, ce sont des histoires d’individus, là aussi, qui ont permis la présence de cette esthétique. À Nantes, il y a une écoute entre les différents acteurs et le jazz a trouvé une place au-delà de ses lieux spécialisés. À Nantes, la politique culturelle est très engagée depuis l’arrivée de Jean-Marc Ayrault.
Michel Hubert – Pannonica : Le choix de personnes comme celui de l’adjoint à la culture est primordial. Ce sont les pierres angulaires des dynamiques culturelles locales.
Les différentes crises récentes démontrent que les relations saines entre les acteurs sont des relations constantes et basées sur le dialogue. Les clubs traversent une crise grave, en même temps que d’autres lieux émergent. Je suis impressionné par le nombre de présentations d’artistes dans des appartements. C’est en train de former une nouvelle forme d’expression artistique. La création d’un lieu commun entre tous les acteurs du jazz est un chantier à réactiver.
Avant que l’écoute que vous évoquez souvent puisse être notable, il y a eu une période où les choses se sont mises en place. Il y a eu le temps des premiers concerts et des premiers lieux, des premiers festivals aussi. Leur développement a-t-il été consécutif à celui des premières écoles et classes de jazz ? Comment s’est faite l’histoire du jazz chez vous ?
Jean-Pierre Layrac : L’histoire du jazz toulousain s’est faite aussi avec ces gens qui ont été des locomotives. Tonton Salut, Marc Démereau, ce sont des gens qui ont trainé beaucoup de choses derrière eux. Si le jazz existe à Toulouse, c’est grâce à une chaîne. Le travail de Music’Halle est très important, ensuite le travail des producteurs, puis les scènes qui programment ces musiciens… On a la chance d’avoir, dans la région, des festivals très différents. Des musiciens s’orientent plutôt vers Marciac, d’autres plutôt vers Luz. Il y a également des salles à Toulouse qui sont importantes.
Loris Pertoldi : Quand je suis arrivé ici, j’ai vu ce concert au Mandala, qui est maintenant Le Taquin, et ça m’a marqué durablement, ça m’a donné envie de faire cette musique et de m’y investir.
Philippe Metz : On ne peut pas parler de scène jazz à Toulouse sans parler de Jeannot (Cartini, ndlr) et du Mandala. Avec un côté un peu libertaire, un peu punk propre à ces années 80. On n’avait pas peur, on y allait quoi ! Y a eu des désastres terribles, économiques et humains mais on y allait, on mettait le feu. À Toulouse, ça résonne très fort cette chose-là.
Jean-Pierre Layrac : Je dirais que notre point faible, c’est la concordance d’énergie. On a mis du temps à travailler ensemble, je crois que dans certaines villes, comme à Tours par exemple, ils ont été plus en avance que nous.
Philippe Metz : C’est vrai qu’on a d’abord eu besoin d’exister, d’identifier un territoire, pour ensuite pouvoir se rencontrer et échanger. Il faut d’abord être fort pour avoir des choses à échanger ensuite. Quand on regarde Le Bijou, Le Bikini, Music’Halle, Avant-Mardi qui est maintenant devenu Octopus… Tout ça, ça se connaissait, ça se respectait mais il n’y avait pas de grande fédération comme on l’a aujourd’hui avec Occijazz.
Fanny Pagès – L’Astrada, Marciac : Sur l’histoire du jazz dans la région et ce grand puzzle, je suis globalement d’accord avec vous, notamment sur le Mandala qui est un lieu mythique, avec tous ces étudiants amateurs de jazz et de musiques improvisées. C’était un endroit extraordinaire et très ouvert. Mais ce que je voulais ajouter concernet les typologies dans l’arborescence des musiciens. Dans l’initiative ‘marciaquaise’, je rejoins Philippe, les expériences devancent les politiques culturelles. L’option jazz au collège de Marciac va bientôt fêter ses 30 ans mais reste une initiative unique en France. Plusieurs établissements en France ont essayé mais c’est toujours un combat car l’Éducation Nationale essaie d’uniformiser ces options et revient régulièrement à la charge sur le collège de Marciac, en prétextant que l’enseignement musical doit être généraliste et pas spécialisé. Ici, l’objet de cette initiation n’est pas de faire émerger des musiciens professionnels mais plutôt de générer des choses à travers l’expérience de la musique jazz. Il se trouve que de nombreux musiciens professionnels ont émergé depuis les premières générations d’élèves, que ce soit Leïla Martial, Emile Parisien, Julien Thouery, les frères Dousteyssier. Il faut aussi mentionner l’enseignant qui a fait le lien Toulouse – Marciac toutes les semaines pendant 30 ans : Jean- Pierre Peyrebelle, malheureusement décédé en septembre 2020. C’est le véritable artisan de cette aventure et c’est aussi ce genre de personnes qui doivent être citées car elles ont beaucoup joué dans la transmission et dans la création de générations de musiciens actuels.
Loïc Breteau : C’est un garçon qui s’appelle Jim Europe qui faisait partie d’un bataillon miliaire qui est arrivé des Etats-Unis. Ils ont fait des concerts sur la côte après avoir débarqué. Ce qui est dit, c’est qu’au Théâtre Graslin, il y a eu un concert de cette formation. C’est pour ça qu’ils parlent d’un « premier » concert. Parce qu’il y a une billetterie, alors qu’avant c’était sur l’espace public. Surtout, il y a eu un article dans la presse pour parler du concert et de cette musique.
Armand Meignan : L’acte est historique oui. Il y a eu d’autres évènements historiques autour du jazz. Le nom du festival des frères Jalladot, c’était le Cercle Nantais du Jazz, et ils ont fait l’un des premiers concerts de Thelonious Monk, à Graslin. Le passé est important dans le rapport de Nantes au jazz, même si ça nous amène aussi au rapport de la ville avec l’esclavage.
Jean-Marie Bellec : Ce tout premier concert a été donné à Graslin, et tout autour, dans les bars, il y avait des musiciens, ça a commencé à infuser. J’ai rencontré Billy Corcuff et Jean Philippe Vidal, des personnages très importants de la scène nantaise, quand je suis arrivé pour jouer. Il y avait un café très important, le Tie-Break, qui était le seul ouvert jusqu’à quatre heures du matin. Le patron adorait la musique et employait tous les soirs un pianiste pour faire du piano bar. Pas fréquent. Les musiciens qui venaient faire la jam étaient arrosés sans limite. C’était important, un lieu de rencontre. Mais je crois que les premiers concerts que j’ai vus c’est au Cercle Nantais ou au Petit Saint. Steve Coleman, McLaughlin…

Une certaine reconnaissance institutionnelle du jazz a lieu au cours des années 80, avec l’arrivée de la gauche au pouvoir et la nomination de Jack Lang au Ministère de la Culture. C’est la deuxième décentralisation, après celle des années Malraux. L’État prend alors en compte le jazz. Notons la création de l’Orchestre National de Jazz et le développement de politiques culturelles d’envergure. Quel impact ont-elles pu avoir sur la scène dont vous êtes parties prenantes ?
Philippe Metz : Ça c’est ce qui est écrit dans vos livres de médiation culturelle mais l’histoire ne s’est pas écrite comme ça. Quand je vais voir le conseiller musique dans les années 80, il me dit qu’on va installer le jazz dans les Conservatoires. Voilà, au revoir monsieur. Si on ne se défend pas, si on ne se bat pas, il n’existe pas ce bordel-là. Par contre, ce qui structure, c’est le Centre Info Jazz (Centre d’information du jazz, ndlr) avec Pascal Anquetil. Des hommes qui ont des idées, de l’énergie, une façon de faire, d’interroger les choses et qui utilisent l’IRMA (le Centre d’information et de ressources pour les musiques actuelles, ndlr) à des fins collectives : faire remonter des informations, créer des pôles, structurer à partir du terrain. Ça s’est arrêté quand il est parti, et aujourd’hui, on le refait d’une certaine façon avec l’AJC.
Jean-Pierre Layrac : Je pense que nos institutionnels ne sont pas plus forts chez nous qu’ailleurs. Il faut être honnête, à Toulouse, on sent que ce n’est pas leur truc. À Nantes, il y a eu une vraie politique culturelle à un moment donné, mais je ne crois pas que ce soit le cas à Toulouse. Ça vient des gens qui se sont bougés.
Loris Pertoldi : Il y a un travail qui se fait au niveau de la fac de musicologie et je pense aussi que c’est ce qui fait la spécificité et la force de Toulouse. Quand je suis arrivé à Music’Halle, il y avait énormément de professeurs. On pouvait avoir un cours de jazz classique et derrière avoir un cours avec Marc Démereau qui nous faisait écouter un mec qui souffle dans une embouchure sans son pendant 30 minutes. Quand on est étudiant en musique, ce grand écart fait qu’on sent qu’on a de la place.
Jean-Philippe Birac – Radio Campus Toulouse : La particularité de Toulouse, c’est quand même qu’il y a trois gros centres de formation autour du jazz. Le Mirail, le Conservatoire et Music’Halle. La nouvelle génération fait des va-et-vient entre ces centres, il y a une ouverture et un potentiel de musiciens assez incroyable depuis ces 15 dernières années. Du côté de la Baraque à Free, ce jeune collectif issu de la fac, certains sont capables de jouer du be-bop, du New Orleans ou du free. Il n’y avait pas ça il y a encore une trentaine d’années.
Jean-Pierre Layrac : Cette variété existe encore, on peut trouver toute forme de jazz et des lieux qui les programment. J’ajouterais la scène alternative qui nourrit cette vivacité. Ce cloisonnement, je pense qu’il n’existe plus nulle part. À Paris, les musiciens du COAX sont capables de faire du swing et du très expérimental le lendemain. Ça fait partie de la mentalité des musiciens aujourd’hui.
Armand Meignan : L’Europa Jazz a été aidé dès les années Lang, d’abord soutenu par la ville et le territoire, puis avec les premières aides de l’État en 82 ou 83. Après, plus d’aides pour les festivals, mais pour les structures de diffusion. Il y a eu des aides nationales, et la création du Panno comme SMAC.
Michel Hubert : En 82-83, je pense que tout le monde a bénéficié du x2 du budget du Ministère de la Culture. Mais depuis, on n’a plus de politique volontariste. L’Etat n’impulse plus rien, comme ça a pu être le cas dans les années Malraux puis Lang. Il est atone et se base sur les cases établies. On a besoin de les dépasser pour comprendre les nouvelles esthétiques. L’émergence se fait dans des lieux qui échappent aux radars et aux grilles de lecture établies du ministère et des collectivités. Ce sont des gens qui ne demandent rien, sont dans des friches et font de belles choses.
Armand Meignan : J’ai souvenir de la revue Jazzman qui a disparu il y a une vingtaine d’années. Ils avaient fait 7 ou 8 pages sur l’émergence de la scène nantaise, pourquoi ? Pour signaler les musiciens nantais qui jouaient au national et à l’international. Leur tête d’affiche c’était Baptiste Trotignon qui a été formé complètement à Nantes. C’est important pour signaler le niveau de cette scène. Il y a des musiciens nantais repérés depuis très longtemps. Par leur reconnaissance, au national et à l’international, ils ont permis de dire qu’il y avait une scène nantaise de très haut niveau. Pareil avec le développement du label Yolk et de leurs musiciens.
Frederic Roy – Association Kiosk : Baptiste Trotignon est sorti à la fois parce qu’il y avait un écosystème de lieux d’éducation et de festivals et clubs. Si on veut comparer à Brest, il n’y a plus de scène, parce que les gens s’en vont. Le Conservatoire ne fonctionne qu’à moitié et les étudiants partent. Il y a les cafés, aussi, qui participent à l’expérience des musiciens. Il faut des musiciens mais aussi des structures et de l’espace.
Jouer sur un territoire structuré, c’est aussi vivre au sein de ce territoire et en animer la scène jazz ? Comment y entre-t-on ? Pourquoi y reste-t-on ? Pourrait-on avoir envie d’en sortir ? Quelles dispositions votre territoire a-t-il pu ou dû défendre pour le corpus de musicien.ne.s présent.e.s et actif.ve.s sur celui-ci ?
Philippe Metz : Dans les années 80-90, il y avait des scènes, des bars ou des clubs qui ont permis à des musiciens de s’ancrer dans la ville. Aujourd’hui moins, on vient d’en perdre un magnifique avec Mix’art. Mais sinon, évidemment avec le savoir-vivre toulousain, le magret est meilleur de ce côté- ci de la Garonne. Sérieusement, je trouve que plein de musiciens ont été fixés à Toulouse par la proposition des écoles où ils ont pu enseigner, en menant de front la carrière de musicien et celle d’enseignant. Il y a aussi tous les Conservatoires satellites qui tournent autour de Toulouse, comme Auch ou Montauban, et qui sont très importants aussi. Music’Halle rentre aussi dans ce système-là et a permis aussi peut-être de ne pas partir à Paris, parce qu’ils avaient les moyens de vivre ici.
Loris Pertoldi : C’est une ville extrêmement riche musicalement, il me semble que c’est la première en France quant au nombre de musiciens professionnels. La qualité de vie joue beaucoup. Après, il y a des musiciens toulousains qui vont à Paris quand l’occasion se présente car il y a accès à des choses qu’on n’a pas ici.
Matthieu Cardon : Je crois aussi que la taille de la ville, pas si grade, fait qu’on a vite fait de se connecter à d’autres musiciens, à L’Impro ou au Taquin. Si tu viens de l’extérieur, tu es peut-être moins noyé qu’à Paris et t’as un champ d’action plus large. Alors après, tu as peut-être moins de visibilité, moins d’accès aux médias.
Fanny Pagès : Pour moi, Toulouse c’est une ville qui, par sa taille humaine, est très vite connectée au monde rural qui l’entoure, où on trouve plein de petits bars associatifs culturels, plein de micro-festivals. C’est un territoire de micro-lieux qui fonctionnent.
Et pourquoi sortir de Toulouse ? Peut-être aussi que le musicien professionnel a besoin de se confronter à autre chose qu’à sa communauté… On est encore dans un système très centralisé au niveau de la production musicale, donc si on a envie de percer le plafond de verre, le passage par la case parisienne est un peu inévitable. Par contre, il y a pas mal de retour en région. On est aussi l’une des grandes villes les plus isolées de Paris au niveau du transport. Quand la ligne TGV entre Paris et Toulouse fonctionnera vraiment, je pense que ça permettra à encore plus d’artistes de revenir s’installer à Toulouse et de faire leurs allers-retours sans avoir à payer des loyers parisiens.
Guillaume Hazebrouk : Ces dernières années, Sébastien Boisseau, notamment, prend ce chemin d’implantation en région. Il est à l’initiative de projets qui lui permettent de jouer davantage en région. C’est une question d’écologie, de circuits courts. Ça a du sens d’être acteur sur son territoire. L’avenir de notre pratique, c’est d’apprendre à s’adresser à des populations qui ne se sentent pas concernées par nos musiques. Être musicien en région, c’est faire le choix d’une carrière dans laquelle on travaille plusieurs strates en même temps.
Michel Hubert : Sur les 30 dernières années, on a senti ça. Des musiciens ne cherchent plus à partir et développent très bien leurs carrières comme ça. La suprématie de Paris pour développer une carrière est en train de se diluer.

Dans notre imaginaire, la question de l’autosuffisance d’une scène se construit en complément ou en opposition à Paris. Au vu de l’organisation centralisée du territoire en France, au vu de la présence des médias et des grandes structures de formation comme le Conservatoire National Supérieur de Musique (CNSM), Paris peut-il faire figure de point de repère incontournable mais aussi de contrexemple à une scène en région. La capitale française est-elle un point de repère ou un partenaire nécessaire ?
Philippe Metz : À Toulouse, on est complètement décentralisés. Ce qui est bien plus intéressant, c’est de travailler avec les autres villes. Aujourd’hui, on a plus besoin de travailler avec Barcelone ou l’Italie qu’avec Paris. Oui, bien sûr, il y a le CNM (Centre national de la musique, ndlr), le ministère de la Culture et les têtes de fédérations qui sont à Paris. Mais pour moi Ceccaldi ça me fait plus penser à Orléans qu’à Paris. Qu’est-ce qu’il reste à Paris ? Les maisons de disques et les labels, y en a plus.
Jean-Pierre Layrac : On ne peut pas travailler avec les autres régions, le problème il est bien là. On a déjà eu du mal à se rencontrer avec Montpellier, Bordeaux c’est inexistant pour nous, Barcelone c’est encore un autre défi. C’est là qu’il faudrait arriver à faire des efforts mais pour ça, on est obligé de passer par Paris.
Matthieu Cardon : Dans les trajectoires des groupes, c’est malheureux mais ça reste quand même important de passer à Paris. Il peut y avoir un peu d’autosuffisance en région, mais il ne faut pas se leurrer. À Toulouse, les loyers augmentent aussi, certains musiciens partent un peu autour pour se loger et ça va générer des initiatives en milieu rural. Si tu arrives à être programmé dans certains festivals, il y a quand même un côté prescripteur qui est plus important. C’est aussi là-bas que tu vas croiser plus de journalistes. Toulouse, à cinq heures de Paris, pour inviter des pros ça reste quand même compliqué.
Fanny Pagès : J’ai toujours tendance à penser que Paris ne doit pas être un objectif quand on est provincial, mais un moyen. C’est un accélérateur, une centrifugeuse qu’il faut utiliser à tous les endroits : production et médias.
Philippe Metz : Je crois que le redécoupage des grandes régions impacte la façon dont on y travaille. Ça nous oblige aussi à circuler plus dans nos grandes régions. Mais il y a un peu un malaise quand même… La Fédurock (Fédération de lieux de musiques actuelles et amplifiées, ndlr) de l’époque, l’AFIJMA (Association des Festivals Innovants en Jazz et Musiques Actuelles, ex- AJC, ndlr), la FNEIJMA (Fédération Nationale des Écoles d’Influence Jazz et Musiques Actuelles, ndlr)… tout ça s’est professionnalisé et je trouve qu’on a perdu nos ancrages territoriaux. Ça créé un déséquilibre entre les régions et Paris.
Fanny Pagès : Je ne crois pas que le modèle parisien soit induit par les financeurs, c’est plus ancien. Le modèle médiatique induit ça aussi : avoir des médias régionaux forts, ça facilite l’autonomie de circulation en interne. On pourrait presque se dire que le modèle du passage par Paris correspond à un modèle productiviste. Il faut vendre, il faut tourner, on veut sortir de la région donc on va à Paris. Or si on choisit un modèle alternatif de développement, on peut sortir très ponctuellement de la région mais ce n’est pas grave, car on arrive à vivre dans la région, l’intermittence fonctionne et ça marche aussi. Ce choix est propre à chacun, aux envies de chaque musicien et musicienne. Paris est un accélérateur mais finalement ça ne change pas l’identité profonde de ce que les artistes ont en eux lorsqu’ils quittent la région. Je pense à Leïla Martial, et ce n’est pas un hasard si elle est allée résider pendant plusieurs semaines dans les forêts du Congo. Parce que cette fille a grandi dans les forêts et montagnes ariégeoises et quelque part c’est presque comme un retour au naturel, aux sources.
Jean-Pierre Layrac : Tu parles de Leïla Martial, j’ai un contre-exemple avec Sylvain Darrifourcq qui a fait ses classes à Toulouse. À un moment donné il s’est dit qu’il était obligé de monter à Paris. Et maintenant Sylvain Darrifourcq, ce n’est plus un artiste toulousain. Quand il revient, il est content et il voit ses amis, mais c’est un musicien parisien. Ça lui a permis de rencontrer des gens grâce au brassage de musiciens. Il n’aurait pas pu le faire à Toulouse. Et à l’inverse, Marc Démereau n’a jamais eu l’intention d’aller chercher ça à Paris. Lui s’est dit, je construis autour de moi avec les musiciens du coin.
Matthieu Cardon : J’ai l’impression qu’on donne à Paris une place trop importante dans notre échange. Oui c’est un passage, mais dans le quotidien tous les musiciens s’en cognent. Quand il y a une belle occasion d’aller y jouer, c’est super. Quand c’est une occasion un peu à l’arrache, c’est comme ça peut l’être ailleurs. Il y a un peu plus d’espoir mis sur le boulot de production, de relations presse qui est plus accentué qu’ailleurs, mais peut-être que ça ne va pas au-delà de ça.
Frederic Roy : Les politiques culturelles favorisent l’installation de musiciens en région. Il se passe beaucoup de choses ailleurs qu’à Paris. C’est peut-être là que l’Etat joue son rôle, dès la structuration. Depuis 20 ans, des lieux poussent partout. C’est aussi ce qui fait que Paris n’est plus vraiment le centre.
Jean-Marie Bellec : J’ai quelques élèves qui ont quitté la France pour suivre des études au Conservatoire supérieur de Bruxelles. Très contents, ils sont restés. Une autre école marche bien, à Lausanne, et là aussi les musiciens restent et ça veut dire qu’ils peuvent travailler. On les revoit aux Rendez-vous de l’Erdre. Au-delà de Paris, l’étranger est intéressant.
Armand Meignan : Est-ce que Paris est encore attractif ? Je ne sais pas si jouer dans un club parisien est plus attractif que jouer au Pannonica. L’intérêt, c’est de jouer dans les festivals, à la Villette, Banlieues Bleues ou Sons d’hiver.

Si Paris n’est plus le centre, retournons à Nantes. Les musiciens en partent puis reviennent pour bousculer un système établi, notamment sur les pratiques de scène. Certes, jouer peut vous changer. Mais voir et écouter ? Comment le public de la scène jazz a-t-il pu évoluer face aux changements que vous notez ?
Loïc Breteau : La fameuse politique volontariste dont on parlait tout à l’heure, au sujet de Nantes, a permis de faire émerger une base de spectateurs relativement large. La démocratisation de l’accès à la culture, c’est acquis à l’échelle de la métropole. Mais il faut aller vers des publics qui ne se déplacent pas vers la métropole.
Frederic Roy : La flambée des prix de l’immobilier, ce n’est pas qu’à Paris et pour cette raison des gens quittent Nantes pour s’installer à la campagne, des gens qui ont pu avoir un important rapport aux propositions artistiques. Ces personnes peuvent être en demande de concerts sans faire 40 kilomètres de voiture. C’est un enjeu d’avenir d’aller chercher des spectateurs en limitant les mobilités. C’est aussi la force du jazz et des musiques improvisées, de pouvoir faire un concert rapidement, sans avoir toute une série d’équipements scéniques pour que quelque chose se passe. Avec Kiosk, on peut faire des concerts partout, facilement adaptables à des situations acoustiques très différentes.
Loïc Breteau : Je pense que c’est l’enjeu, le rapport de la culture à son territoire. Les métropoles ont capté ça mais la culture doit toucher de façon plus large. Les métropoles doivent participer à une présence culturelle, au-delà de leurs murs.
Jean-Marie Bellec : On pourra faire aussi un travail sur le rajeunissement des publics de jazz. C’est parfois terrifiant pour moi de ne voir que des vieux comme moi. J’aimerais voir des jeunes au-delà de ceux qui sont au Conservatoire.
Michel Hubert : On constate ça dans les SMAC, aussi. L’âge moyen est plutôt élevé. C’est un vrai problème. Toute une partie des publics et des praticiens est en dehors des scènes dont on parle. La question c’est aussi de prendre en compte des pratiques qui sont nouvelles, y compris pour l’enseignement. La logique des autodidactes est à prendre en compte. Ce sont des gens, reconnus d’un circuit parallèle, qu’on retrouve sans les avoir vus passer. On est en retard sur cela. Sur le plan social, il y a des quartiers entiers qui sont écartés. Il faut faire du hors les murs et croiser de nouveaux public. L’itinérance est une nouvelle voie pour susciter des curiosités et des vocations.
Du côté de Toulouse, la spécificité de la scène a su se révéler, grâce à sa position géographique, ouverte, mais aussi et surtout grâce à une coopération progressive mais solide de ses différent.e.s acteur.rice.s. Cette coopération aurait pu laisser apparaitre un autre élément structurant pour fonder ou laisser émerger une scène de territoire, le festival. Or, ce qui peut sembler étonnant, c’est qu’il n’y ait pas de grand festival à Toulouse, alors que Jazz à Luz et Jazz in Marciac font figure de repères nationaux majeurs.
Jean-Pierre Layrac : Marciac et Luz, pour les musiciens, c’est un repère. Certains créent des choses car ils veulent les placer à Luz, par exemple. Ça crée une envie, c’est très important. Le festival a un vrai rôle dans l’orientation musicale prise par certains musiciens.
Fanny Pagès : Jazz in Marciac a modifié le territoire du Gers et a marqué une empreinte dans l’identité culturelle de l’Occitanie, au-delà des frontières régionales. Ça reste un phénomène ! Ça touche au dynamisme économique du département, à son attractivité. Et si l’Astrada, est là, c’est parce qu’il y a Jazz in Marciac. C’est une façon de pérenniser un projet culturel dans le temps, de l’installer. Ça change beaucoup de choses pour un territoire.
Matthieu Cardon : Luz, l’identité est là, elle est forte et je sais que ça peut être un partenaire pour monter des choses. Ce n’est pas le cas de Jazz sur son 31, qui est monté par une institution, le département, et qui du coup va arroser un peu partout. Il me semble qu’à Toulouse, il n’y a pas cet acteur-là, un festival un peu fort, qui ait une identité marquée.
Jean-Pierre Layrac : Moi je crois que la vivacité d’une scène est liée à la diffusion. Ce que fait Freddy Morezon avec Freddy Taquine au Taquin, c’est important. Ce côté laboratoire, ça permet de se confronter à des musiciens et à un public. Et là on entre dans le travail du collectif.
Fanny Pagès : Concernant le décloisonnement des esthétiques sur les scènes généralistes, j’ai du mal à évaluer si c’est pareil dans les autres pays mais je trouve qu’ici on reste très cloisonné dans nos disciplines. Ce qui est artistiquement ou philosophiquement parfois hyper frustrant. C’est pas facile pour des musiciens de jazz d’être diffusés dans des scènes généralistes. C’est aussi un problème institutionnel je pense. Le ministère de la Culture a créé des cases très précises, des labels, des SMAC, des scènes nationales. Et malheureusement dans les scènes généralistes, ils ne sont souvent pas formés aux musiques jazz, pour certains ça ne les intéresse même pas. Casser un peu les codes, arriver à faire que ça circule un peu mieux, c’est une mission de notre côté, mais il faut une volonté dans les politiques culturelles. Que ces scènes généralistes soient vraiment généralistes !
Pierre-Olivier Bobo
Arthur Guillaumot
Guillaume Malvoisin

En 2022, dans le cadre du projet Footprints Le Périscope et AJC publiaient une étude intitulée : Quel impact Carbone pour les lieux et festivals

Plusieurs festivals et lieux membres d’AJC se réuniront fin mars 2024 au Périscope à Lyon. Ce dernier séminaire Landscape traitera des questions de l’alimentation et

Pierre Dugelay / Directeur du Périscope, jazzclub à Lyon Comment le Périscope envisage- t-il sa programmation, en particulier pour les artistes étranger·ères ? Le Périscope